Les controverses de la mise en œuvre de l’état d’urgence et limites du contrôle du juge administratif
Le 14 novembre 2015, quelques heures seulement après les sanglants attentats terroristes qui ont frappé la capitale française, le gouvernement a déclaré la mise en œuvre d’un régime de crise, l’état d’urgence. Il permet une concentration des pouvoirs de certaines autorités étatiques conduisant à une adaptation du principe de légalité au défi sécuritaire. Si l’état d’urgence, découlant de la loi du 3 avril 1955 a été utilisé à plusieurs reprises, il faut s’intéresser à sa nouvelle mouture, faisant fi de certaines garanties constitutionnelles, conventionnelles. En effet, la loi du 20 novembre 2015 a étoffé les pouvoirs de l’exécutif, tout en consacrant un contrôle des mesures de police prises sur son fondement quasi exclusivement réservé au juge administratif. Il faudra donc étudier la justification de cette surestimation du rôle de la juridiction administrative, et savoir si les juges administratifs sont à la hauteur de la mission qui leur a été confiée.
« De quelque manière que l’on tourne les choses, l’état d’urgence, c’est la mise en suspension de l’État de droit : les principes constitutionnels qui le fondent et le distinguent et les mécanismes et exigences du contrôle juridictionnel sont mis à l’écart. Si l’État de droit est, définition minimale, un équilibre entre respect des droits fondamentaux et sauvegarde de l’ordre public, l’état d’urgence, c’est le déséquilibre revendiqué au profit de la sauvegarde de l’ordre public »[1].
Le droit a pour vocation l’organisation de la vie sociale, si celle-ci se trouve gravement perturbée, l’instrument juridique devra adapter le principe de légalité ou juridicité aux nécessités sécuritaires. En effet, conformément au principe de l’Etat de droit, l’administration est tenue de respecter ce principe de légalité, elle est donc soumise aux différentes sources de la légalité administrative qu’elles soient nationales, supranationales, écrites ou non écrites.
Face à des situations exceptionnelles, des crises graves, ou anomalies préjudiciables, l’Etat de droit devra user de méthode de contrainte pour assurer le maintien de l’ordre public. Le droit français dispose à ce titre de plusieurs mécanismes juridiques autorisant une concentration ou intensification des pouvoirs allant de pair avec une restriction des droits. Plusieurs mécanismes[2] ont vu le jour permettant temporairement, pour gagner en efficacité et sécurité, de « mettre un voile sur les liberté»[3]. Parmi ceux-ci, il convient de s’intéresser au régime de crise actuellement mis en place en France, l’état d’urgence.
Le projet de loi instituant l’état d’urgence a été présenté au Parlement par le Gouvernement d’Edgar Faure pour faire cesser les insurrections armées et renforcer les pouvoirs des autorités de police en Algérie. Justifiée dans l’exposé des motifs par une « insuffisance des moyens de droit »[4], cette loi fut qualifiée successivement de « loi scélérate », « état de siège fictif aggravé »[5]. Elle fut finalement adoptée le 3 avril 1955[6], modifiée par l’ordonnance du 15 avril 1960[7]. Il pourra être déclaré sur tout ou partie du territoire par décret en Conseil des ministres « soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas d’événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique »[8]. Son intérêt principal se caractérise dans l’extension et la concentration des pouvoirs de police au profit de certaines autorités administratives telles, le ministre de l’Intérieur et le préfet.
Son utilisation ne s’est pas cantonnée à la guerre d’Algérie, il a également été déclaré à l’occasion des actions indépendantistes en Nouvelle-Calédonie[9], en métropole à la suite de ce qui a été qualifié d’émeutes urbaines[10]. Si l’état d’urgence, découlant de la loi du 3 avril 1955 a été utilisé à plusieurs reprises, sa nouvelle mouture semble faire fi de certains motifs d’inconstitutionnalité, d’inconventionnalité. Le Gouvernement a ainsi indiqué au secrétaire général du Conseil de l’Europe qu’il se prévalait de la faculté de déroger à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et libertés fondamentales ouverte par son article 15[11].
Le 14 novembre 2015, au lendemain des tragiques attentats terroristes perpétrés sur la capitale, l’état d’urgence a de nouveau été décrété en Conseil des ministres[12]. Appliqué initialement au département d’Ile de France[13], son périmètre a progressivement été étendu à l’ensemble du territoire métropolitain[14], puis sur le territoire des collectivités d’outre-mer[15]. Suite à cela, la loi du 20 novembre 2015[16] a permis d’étoffer les mesures prévues originellement par la loi du 3 avril 1955[17] et de proroger l’état d’urgence. Par la suite, cet état d’urgence a été prorogé deux fois, par une loi du 19 février 2016 pour une durée de trois mois[18], puis par une loi du 26 mai 2016 jusqu’au 26 juillet prochain[19].*
La loi du 3 avril 1955 telle que modifiée en 2015 ne définit pas un régime unique ; elle énonce les mesures de police attentatoires aux libertés, susceptibles de recevoir application : interdiction de circulation (article 5)[20], assignation à résidence (article 6)[21], dissolution des associations et groupements de fait (article 6-1), fermeture provisoire des salles des lieux de réunion (article 8)[22], réquisition de personnes ou de biens (article 10)[23], perquisition de jour et de nuit (article 11)[24], saisie et exploitation des données personnelles (article 11)[25], interruption des services de communication au public (article 11, II).
Le contrôle que réalise le juge administratif sur les mesures de police prises en application de la loi du 3 avril 1955 modifiée doit être analysé, ce d’autant que son rôle a été très largement surestimé, surévalué par le législateur.
Il faudra ainsi étudier premièrement la loi du 20 novembre 2015[26] qui en consacrant un quasi-monopole du contrôle des mesures de police au profit de la juridiction administrative, a procédé à un véritable effeuillage des pouvoirs habituellement conférés au juge judiciaire. Deuxièmement, plusieurs soupçons semblent peser sur le juge administratif dans le contrôle qu’il réalise sur les mesures administratives découlant de la loi relative à l’état d’urgence. Il conviendra alors de le décrypter pour déterminer s’il s’agit ou non d’un contrôle frileux.
- La surestimation du rôle du juge administratif.
Le juge administratif n’a que tardivement été considéré comme un juge gardien des libertés fondamentales. Pour qu’il soit érigé en protecteur de celles-ci, il a donc fallu qu’il convainque, qu’il persuade et désarme les méfiances qui pesaient originellement contre lui. La fin du XXème et le début du XXIème siècle seront alors déterminants tant pour solidifier son assise, renforcer son office que forger le mythe d’un juge garant des droits fondamentaux. Dans cette logique, de nombreuses exigences semblaient devoir être attendues du juge administratif dans le cadre de son contrôle sur les mesures de police émanant de la loi du 3 avril 1955 ; ce d’autant que dans sa nouvelle mouture, à l’exception de la commission des infractions reconnues à l’article 13[27], le législateur l’a doté d’un contrôle exclusif de ces mesures de police. Cette réserve de compétence au profit du juge administratif et plus particulièrement au juge des référés est explicitée à son article 14-1[28]. L’autorité judiciaire y apparait totalement muselée. Le premier président de la Cour de cassation, Bertrand Louvel a questionné Christiane Taubira, alors Garde de sceaux, sur les défaillances ou risques que présenterait l’autorité judiciaire pour expliquer que l’Etat préfère l’éviter[29]. A lire le rapport présenté devant l’Assemblée nationale par Jean-Jacques Urvoas, actuel Garde des sceaux, la seule justification tiendrait à la nécessité de répondre avec efficacité à la menace terroriste[30]. Le but parait être de parvenir à une certaine instantanéité dans l’application des mesures de police.
Les magistrats de l’autorité judiciaire ont dénoncé publiquement cette méfiance à leur égard et fait part de leurs inquiétudes les plus vives concernant les mesures législatives encadrant l’état d’urgence[31]. Il nous semble important de livrer l’amorce de cette déclaration :
« Dans un pays tragiquement endeuillé et attaqué dans ses fondements démocratiques les plus précieux, l’autorité judiciaire doit, plus que jamais, assumer le rôle et la place qui lui sont reconnus par la Constitution » dans la défense des libertés individuelles.
Tel que l’affirme l’article 66 de la Constitution :
« Nul ne peut être arbitrairement détenu. – L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi “.
Il faut rappeler ici la distinction à laquelle procède le Conseil constitutionnel entre les mesures « privatives » de liberté, contrôlées par le juge judiciaire, et celles « restrictives » de liberté relevant de la compétence du juge administratif. Le législateur modifiant la loi du 3 avril 1955 a toutefois confié le contrôle des mesures de police (assignation à résidence, perquisition, saisie) au juge administratif. En matière d’assignation à résidence, le Conseil constitutionnel avait considéré qu’une telle mesure, affectant un ressortissant étranger sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français, ne comportait « aucune privation de la liberté individuelle » au sens de l’article 66 de la Constitution[32]. En matière de perquisition judiciaire, les sages du Palais Royal ont par exemple assimilé la possibilité de diriger des perquisitions de jour ou de nuit au contrôle de l’autorité judiciaire en tant que gardienne de la liberté individuelle[33]. Historiquement, si l’on se reporte à la prorogation de l’état d’urgence en novembre 2005, les parlementaires s’étaient questionnés sur l’opportunité d’un contrôle des perquisitions administratives par le juge administratif. Ils s’étaient toutefois accordés sur la nécessité de ne pas soustraire ces mesures de police à l’autorité judiciaire. Pascal Clément, alors garde des sceaux, affirmait solennellement, que les préfets ne pourraient décider une perquisition en application de l’état d’urgence « qu’après accord -et non avis – du procureur de la République »[34]. Pourtant dix ans plus tard, malgré la jurisprudence du Conseil constitutionnel, les parlementaires ont substitué à une autorisation préventive de l’autorité judiciaire, un contrôle a-posteriori du juge administratif. Cette incohérence avait d’ailleurs été maladroitement dénoncée par le député Patrick Devedjian lors de la discussion générale du projet de loi devant l’Assemblée nationale[35]. Il indique que « malgré la Constitution, on a substitué le juge administratif au juge judiciaire, ce remplacement provoquant un débat ». S’il relève la probable inconstitutionnalité du projet de loi, le débat n’a pas eu lieu et la question s’est trouvée rapidement recouverte par le flot des interventions. Philippe Bas, rapporteur du projet de loi devant le Sénat a alors qualifié le régime des perquisitions administratives de mesure « problématique au regard du cadre constitutionnel »[36].
Par le biais de plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a pu se positionner sur la constitutionnalité de certains articles de la loi du 20 novembre 2015. Il a ainsi déclaré conforme à la Constitution et ne constituant pas une privation de la liberté individuelle, l’article 6 de la loi du 3 avril 1955 modifiée relatif au régime des assignations à résidence[37]. Il a par contre censuré une partie des dispositions du 3ème alinéa de l’article 11 relatives à la saisie et l’exploitation des données collectées comme contraire à la Constitution[38]. En dehors de celles-ci, le Conseil constitutionnel a validé les restrictions apportées à la compétence de l’autorité judiciaire, notamment en matière de perquisitions. En soustrayant du champ de la liberté individuelle, protégée par l’article 66 de la Constitution, le droit au respect de la vie privée, droit autonome[39], le Conseil constitutionnel valide la compétence unique du juge administratif. Cette recherche de compromis a évidemment son lot d’insatisfactions. Notamment le fait, d’intégrer ou non le droit au respect de la vie privée dans le champ de la liberté individuelle selon que l’on se place dans une opération diligentée par la police administrative ou judiciaire. Mais aussi, la divergence de protection de ce droit selon que la perquisition est prononcée par la police administrative ou diligentée par la police judiciaire.
- La frilosité du contrôle du juge administratif
Saisi du contrôle exclusif des mesures de police prises dans le cadre de l’état d’urgence, il faut déterminer si le juge administratif est à la hauteur de la mission qui lui a été confiée, et s’il en a les moyens. A ces deux questions, il semble qu’il faille répondre par la négative.
A priori, le juge administratif a taché de renforcer à la fois l’effectivité et l’intensité de son contrôle pour assurer l’équilibre entre la sauvegarde de l’ordre public et la préservation des libertés fondamentales dès qu’il en a eu l’opportunité. Dans plusieurs ordonnances rendues le 11 décembre 2015[40], le Conseil d’Etat a considéré premièrement que dans le cadre de la contestation d’une assignation à résidence, la condition d’urgence inhérente au référé-liberté était présumée. La juridiction administrative suprême vient fixer une ligne directrice harmonisant les positionnements des juges de première instance en ouvrant largement le prétoire de la justice administrative. Deuxièmement, par obiter dictum, le juge de l’excès de pouvoir précise qu’il exercera un contrôle entier sur les motifs et les modalités de mise en œuvre de la mesure de police. Xavier Domino, alors rapporteur public, appelait les membres de la Section du contentieux à effectuer une telle revalorisation du contrôle en s’exprimant ainsi :
« Il nous semble important que votre décision envoie le signal clair, tant à l’égard de l’administration, des citoyens que des juges, que le contrôle exercé par le juge administratif sur les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence n’aura rien d’un contrôle au rabais, et que l’état de droit ne cède pas face à l’état d’urgence »[41].
La valeur symbolique de cette annonce ne doit pas être négligée, car à cette même date la Section de l’intérieur du Conseil d’Etat rendait un avis[42] validant le projet de loi constitutionnelle inscrivant dans le marbre constitutionnel les conditions de déclaration et de prorogation de l’état d’urgence[43]. La compétence du juge administratif en la matière aurait de ce fait un fondement constitutionnel[44].
Plusieurs suspicions pèsent cependant sur le contrôle qu’il exerce et nous conduisent à cette considération du mythe de la garantie des libertés et droits fondamentaux.
En premier lieu, à la lecture des décisions rendues, il est possible de le suspecter d’exercer un contrôle frileux, imprégné par le climat d’angoisse inauguré par l’état d’urgence. Il convient d’indiquer que seules peu d’ordonnances rendues en référé par le juge administratif ont suspendu la mesure de police contestée, environs 16% seulement selon les chiffres communiqués par le Conseil d’Etat[45]. En matière d’assignation à résidence, le juge administratif des référés réalise une appréciation de la mesure prise par l’autorité administrative « compte tenu de la situation ayant conduit à la déclaration de l’état d’urgence »[46]. Le juge des référés a également pu ajouter dans certaines ordonnances « qu’il lui appartient de tenir compte, dans son appréciation, des nécessités provenant de l’état d’urgence, selon les circonstances de temps et de lieu , la catégorie des individus visés et la nature des périls qu’il importe de prévenir»[47]. Il semblerait ainsi que le contrôle de proportionnalité réalisé par le juge administratif s’adapte aux nécessités sécuritaires de l’état d’urgence, faisant preuve d’une plus grande souplesse dans l’appréciation des excès de l’autorité administrative.
De plus, certains juges, sortant de leur devoir de réserve, ont dénoncé la faiblesse de leur marge de manœuvre, témoignant anonymement des difficultés rencontrées dans leur contrôle des mesures de police[48]. Ils affirment : « lorsque la loi, comme c’est le cas de celle portant application de l’état d’urgence, instaure un état d’exception (…), le pouvoir du juge est limité : il doit seulement vérifier si les mesures exceptionnelles autorisées par l’état d’urgence pouvaient être prises à l’encontre des personnes concernées.». En substance, la garantie des droits fondamentaux ne serait assumée par le juge administratif que pour autant que la loi l’y autorise ce qui entache grandement ce rôle de gardien des droits fondamentaux qu’on lui prête.
En deuxième lieu, il est possible de critiquer la validation par le juge administratif de l’extension des mesures d’assignation à résidence à l’encontre de certains militants écologistes[49]. Profitant de l’effet d’aubaine, le pouvoir exécutif a usé de l’arsenal sécuritaire pour des motifs étrangers de ceux ayant légitimés l’état d’urgence. Cette instrumentalisation n’est pas passée inaperçue parmi les Organisations non gouvernementales, les membres de la justice administrative et la doctrine. Dans son rapport de 2015, Amnesty international a pointé du doigt cette pratique visant à user de l’état d’urgence à d’autres fins que celles ayant fondé son initiation[50]. Dans son avis du 18 février 2016, la Commission nationale consultative des Droits de l’Homme parle d’un « détournement de l’état d’urgence »[51]. C’est cette question de l’extension du champ d’application de l’état d’urgence que le Syndicat de la justice administrative a pu soulever lors d’une audition devant l’Assemblée nationale[52]. Enfin, la doctrine s’en est également étonnée[53]. Toutefois, le Conseil d’Etat dans ses décisions du 11 décembre 2015 a validé cette extension en se référant au texte de la loi et à la différence qu’elle établit entre les motifs justifiant la déclaration de l’état d’urgence et les motifs permettant une assignation à résidence prévue à l’article 6 de la loi du 3 avril 1955 modifiée. Pourtant, si l’on s’intéresse aux travaux parlementaires, ni l’étude d’impact, ni l’exposé des motifs de la loi n’étendent le champ de l’assignation à résidence à d’autres personnes que celles suspectées d’appartenance à la mouvance terroriste.
De plus, le professeur Agnès Roblot-Troizier a soulevé une incohérence dans le dispositif de ces ordonnances. Le Conseil d’Etat était saisi à la fois d’un appel et de plusieurs pourvois dans le cadre de la procédure du référé liberté. L’un des militants écologistes avait également demandé à la juridiction administrative suprême de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité des dispositions de l’article 6 de la loi du 3 avril 1955 modifiée aux droits et libertés garantis par la Constitution. Alors que les conseillers d’Etat considèrent que les assignations à résidence ne portent pas une « atteinte grave et manifestement illégale » à la liberté d’aller et venir des administrés, et que les affaires ne nécessitent pas l’adoption de mesure de sauvegarde, ils décident de saisir le Conseil constitutionnel de l’article 6 de la loi en raison du caractère sérieux du moyen d’inconstitutionnalité. Pour le formuler autrement alors que le pré-contrôle de constitutionnalité les pousse à reconnaitre la pertinence de l’inconstitutionnalité de l’article 6, ils ne retiennent pas que l’assignation à résidence puisse porter une « atteinte grave et manifestement illégale » à la liberté d’aller et venir en tant que liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du CJA.
En troisième lieu, il faut se questionner sur la prise en compte dans l’instruction des « notes blanches » fournies par l’administration. Il s’agit du document produit par les services de renseignement recensant les griefs ayant conduit aux mesures de police contestées. Le plus souvent, il s’agit du seul élément étayant la mesure de police. Au titre du contrôle de proportionnalité, le juge administratif examine les motifs ayant justifié le prononcé de la mesure de police, exposés dans ces « notes blanches ». Il a toutefois été suspecté de reprendre purement et simplement les moyens développés par les services de renseignement de l’administration, sans examen critique. La charge de la preuve serait ainsi inversée et l’administré contraint de rapporter la preuve de la fausseté de ces notes. Bernard Stirn, Président de la Section du contentieux, a lui-même indiqué que les juges administratifs partent « du principe que les services de renseignement travaillent de façon honnête, et qu’ils n’affabulent pas dans les notes blanches ». Puisqu’il y a une présomption de vérité des notes blanches, les juges vont se borner à vérifier lors du débat contradictoire si « le contenu de ces notes est contesté de manière crédible sur le fondement d’éléments établis par l’intéressé »[54]. Le Syndicat des avocats de France, dans l’analyse du contrôle réalisé sous l’état d’urgence, condamne l’admission par le juge administratif de « ces preuves préconstituées et invérifiables produites par les services de renseignements ». La preuve de l’absurdité de ces notes constituerait une démonstration impossible selon laquelle « l’inexistant n’existe pas »[55].
Cependant, dans certaines espèces, le juge se veut rassurant dans la mesure où il ne prendra en compte ses notes que lorsqu’elles seront « suffisamment précises et circonstanciées »[56], et s’attache « à ce que seuls les éléments de faits contenus dans la note soient regardés comme probants, à l’exclusion de toute interprétation ou extrapolation »[57]. Dans une ordonnance en date du 6 janvier 2016, le juge administratif refuse de se fonder sur ces notes en raison de leur imprécision[58]. D’ailleurs le Vice-Président du Conseil d’Etat a précisé que dans le cas où « les allégations sont floues, imprécises ou inconsistantes, elles risquent de n’être pas de nature, au titre du contrôle de proportionnalité, à justifier la mesure prise par l’autorité administrative»[59].
Par conséquent, le contrôle exercé par le juge administratif dans le cadre de l’état d’urgence tend à démythifier cette représentation du juge administratif, gardien des libertés fondamentales. A défaut de pouvoir être l’idéal protecteur, il a été envisagé comme un arbitre exclusif tranchant entre les volontés sécuritaires des pouvoirs publics et la préservation des droits fondamentaux des justiciables. Un arbitre qui bien qu’usant des instruments qui lui ont valus la qualification de gardien des libertés fondamentales, reste contraint par les dispositions rigides de la loi du 20 novembre 2015.
Un juge dont le contrôle frileux semble emprunt du climat d’inquiétude suscité par l’état d’urgence, un équilibriste dans l’embarras de la définition d’une conciliation entre la sauvegarde de l’ordre public et la préservation des droits et libertés fondamentaux. Un administrateur qui n’oserait « pas prendre la responsabilité de remettre en cause l’efficacité de la politique menée par les pouvoirs publics pour protéger la population des menaces terroristes »[60].
* Après les attantats de Nice le 14 juillet 2016, l’état d’urgence a été prolongé pour une durée de 6 mois jusqu’à janvier 2017. (note CGFR)
[1] Rousseau Dominique, « L’état d’urgence, un état vide de droit(s) », Revue Projet 2/2006 (n° 291), p. 19-26.
[2] Les pouvoirs de crise ou exceptionnels confiés au Président de la République par l’article 16 de la Constitution : « Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacés d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des Présidents des Assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel. »/ L’état de siège prévu par la loi du 9 aout 1849 est repris à l’article 36 de la Constitution : « L’Etat de siège est décrété en Conseil des ministres. Sa prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par le Parlement. »/ Jurisprudence des circonstances exceptionnelles initiée par les arrêts « Heyriès » (CE, n° 63412, 28 juin 1918, publié au recueil), « Dames Dol et Laurent » (CE, n° 61593, 28 février 1919).
[3] Montesquieu, « De l’esprit des lois », Livre XII, Chapitre 19.
[4] Exposé des motifs du projet de la loi.
[5] Raymond Guyot, Alice Sportisse, Débats parlementaires devant l’Assemblée nationale, les 30 et 31 mars 1955.
[6] Loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence.
[7] Ordonnance n°60-372 du 15 avril 1960 modifiant certaines dispositions de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 instituant un état d’urgence.
[8] Article 1er, loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence : «L’état d’urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain, des départements d’outre-mer, des collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas d’événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique. »
[9] Arrêté n° 85-35 du 12 janvier 1985 du haut-commissaire de la République.
[10] Décret n°2005-1386 et n° 2005-1387 du 8 novembre 2005 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955.
[11] Article 15-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales : « En cas de guerre ou en cas d’autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Convention, dans la stricte mesure où la situation l’exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international. ».
[12] Décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955.
[13] Décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955.
[14]Décret n° 2015-1478 du 14 novembre 2015 modifiant le décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955.
[15] Décret n° 2015-1493 du 18 novembre 2015 portant application outre-mer de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955.
[16] Loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et renforçant l’efficacité de ses dispositions.
[17] Loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence.
[18] Loi n° 2016-162 du 19 février 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence.
[19] Loi n° 2016-629 du 26 mai 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence
[20] Article 5, loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence : « La déclaration de l’état d’urgence donne pouvoir au préfet dont le département se trouve en tout ou partie compris dans une circonscription prévue à l’article 2 :1° D’interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par arrêté ; 2° D’instituer, par arrêté, des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé ;3° D’interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l’action des pouvoirs publics. »
[21] Article 6 paragraphe 1, loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence : « Le ministre de l’intérieur peut prononcer l’assignation à résidence, dans le lieu qu’il fixe, de toute personne résidant dans la zone fixée par le décret mentionné à l’article 2 et à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics dans les circonscriptions territoriales mentionnées au même article 2. Le ministre de l’intérieur peut la faire conduire sur le lieu de l’assignation à résidence par les services de police ou les unités de gendarmerie. ».
[22] Article 8, loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence : « Le ministre de l’intérieur, pour l’ensemble du territoire où est institué l’état d’urgence, et le préfet, dans le département, peuvent ordonner la fermeture provisoire des salles de spectacles, débits de boissons et lieux de réunion de toute nature dans les zones déterminées par le décret prévu à l’article 2.Peuvent être également interdites, à titre général ou particulier, les réunions de nature à provoquer ou à entretenir le désordre. ».
[23] Article 10, loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence : « La déclaration de l’état d’urgence s’ajoute aux cas prévus à l’article L. 1111-2 du code de la défense pour la mise à exécution des réquisitions dans les conditions prévues au livre II de la deuxième partie du même code. ».
[24] Article 11 paragraphe 1, loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence : « Le décret déclarant ou la loi prorogeant l’état d’urgence peut, par une disposition expresse, conférer aux autorités administratives mentionnées à l’article 8 le pouvoir d’ordonner des perquisitions en tout lieu, y compris un domicile, de jour et de nuit, sauf dans un lieu affecté à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics. ».
[25]Article 11 paragraphe 3, loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence : « Il peut être accédé, par un système informatique ou un équipement terminal présent sur les lieux où se déroule la perquisition, à des données stockées dans ledit système ou équipement ou dans un autre système informatique ou équipement terminal, dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial. ».
[26] Loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et renforçant l’efficacité de ses dispositions.
[27] Article 13, loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence : « Les infractions aux articles 5, 8 et 9 sont punies de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. Les infractions au premier alinéa de l’article 6 sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. Les infractions au deuxième et aux cinq derniers alinéas du même article 6 sont punies d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. L’exécution d’office, par l’autorité administrative, des mesures prescrites peut être assurée nonobstant l’existence de ces dispositions pénales. ».
[28]Article 14-1de la loi du 3 avril 1955 : « A l’exception des peines prévues à l’article 13, les mesures prises sur le fondement de la présente loi sont soumises au contrôle du juge administratif dans les conditions fixées par le code de justice administrative, notamment son livre V. ».
[29] Audience solennelle de rentrée, Cour de Cassation, 14 janvier 2016.
[30] Jean-Jacques Urvoas, Rapport n° 3237 déposé le 19 novembre 2015 devant l’Assemblée nationale.
[31] Délibération adoptée par la conférence des premiers présidents le 14 janvier 2016.
[32] CC, Décision n° 2011-631, 9 juin 2011, Loi relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, considérant 68.
[33] CC, Décision n°2004-492 DC du 2 mars 2004, Loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité / DC, 16 juillet 1996, n°96-377, Loi tendant à renforcer la répression du terrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires de l’autorité publique ou chargées d’une mission de service public et comportant des dispositions relatives à la police judiciaire.
[34] Pascal Clément, Compte rendu intégral des débats en séance public, 16 novembre 2005.
[35] Patrick Devedjian, Discussion Générale, Rapport n° 3237 déposé le 19 novembre 2015 devant l’Assemblée nationale.
[36] Philippe Bas, Rapport n° 177 déposé le 19 novembre 2015 devant le Sénat.
[37] CC, n°2015-527, QPC, 22 décembre 2015.
[38] CC, n°2006-536, QPC, 19 février 2016.
[39] Ce droit a été rattaché à l’article 2 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression. ».
[40] CE, n° 395009, 11 décembre 2015, Cédric D., Lebon ; AJDA 2016. 247/ n°394989, M. Joel D./ n° 394490, M. Luc G. / n° 394991, M. Corentin V. / n°394992 M. Pierre B. / n°394993, Mme Marion S./ n°395002, Mme Soizic C.
0[41] Xavier Domino, conclusion sous l’arrêt Section, 11 décembre 2015, RFDA 2016. 105.
[42] Avis CE, Section de l’intérieur sur le projet de loi constitutionnelle de protection de la Nation, n° 390866, 11 décembre 2015. Elle a considéré que les modifications apportées à la loi du 3 avril 1955 permettaient « au législateur, lorsque ces mesures administratives ne relèvent pas de l’article 66 de la Constitution, de les soumettre exclusivement au contrôle du juge administratif et non à celui du juge judiciaire ».
[43] Projet de loi constitutionnelle n°3381 de protection de la Nation
[44] Exposé des motifs, Projet de loi constitutionnelle n° 3381 de protection de la Nation : « Les mesures prises sur le fondement du nouvel article 36-1 de la Constitution seront placées sous le contrôle du juge administratif sauf à relever du domaine réservé au juge judiciaire par l’article 66 de la Constitution. Ainsi, le législateur pourra prévoir des mesures restrictives de liberté (escorte jusqu’au lieu d’assignation à résidence, retenue au début de la perquisition…) ou des mesures conciliant l’article 36-1 avec la liberté d’aller et venir (assignation à résidence…). Ces mesures non privatives de liberté, qui ont pour objet de prévenir les atteintes à la sécurité et à l’ordre publics, n’ont pas à être placées sous le contrôle de l’autorité judiciaire. Elles seront placées sous le plein contrôle du juge administratif. »
[45] Site du Conseil d’Etat, Récapitulatif au 25 février 2016 : sur 106 mesures, les juges des référés (TA et CE compris) en ont suspendu 16.
[46] CE, Ordonnance n° 396743, 12 février 2016/ CE, Ordonnance n°396737, 11 février 2016/ CE, Ordonnance n°397202, 25 février 2016.
[47] TA Clermont-Ferrand, Ordonnance n°1600065, 16 janvier 2016/
[48] Site internet de Médiapart : « Etat d’urgence : des juges administratifs appellent à la prudence ».
[49]CE, n° 395009, 11 décembre 2015, Cédric D., Lebon ; AJDA 2016. 247/ n°394989 M. Joel D./ n° 394490 M. Luc G. / n° 394991 M. Corentin V. / n°394992 M. Pierre B. / n°394993, Mme Marion S./ n°395002, Mme Soizic C.
[50] Rapport Amnesty international 2015/2016.
[51] Commission nationale consultative des droits de l’homme, avis 18 février 2016 sur le suivi de l’état d’urgence, p.5.
[52] Assemblée nationale, Rapport n°3784 enregistré le 25 mai 2016 sur le contrôle parlementaire de l’état d’urgence. Hélène Bronnenkant, secrétaire générale du syndicat de la justice administrative a relevé que ce positionnement suscite les « interrogations de bon nombre d’entre nous sur le fait de savoir si la jurisprudence du Conseil d’État est parfaitement compatible avec notre cœur de métier, qui est de faire respecter l’État de droit ».
[53] Agnès Roblot-Troizier, Assignations à résidence en état d’urgence, Note sous Conseil d’État, Section, 11 décembre 2015, M C. Domenjoud, n° 395009, RFDA, 2016, p. 123/ Serge Deygas, Quel contrôle du juge administratif sur les assignations à résidence, Procédures n°2, Février 2015, Comm. 77. / Gweltaz Eveillard, État d’urgence : les assignations à résidence devant le juge administratif et le Conseil constitutionnel, Droit administratif n°4, Avril 2016, Comm. 25. / Olivier Le Bot, Référé-Liberté et état d’urgence, Petites Affiches, 08/03/2016, n°48, p. 8.
[54] Bernard Stirn, Assemblée nationale, Rapport n°3784 enregistré le 25 mai 2016 sur le contrôle parlementaire de l’état d’urgence.
[55] Anaïs Coignac, journaliste, L’état d’urgence, la justice et les avocats, La Semaine Juridique Edition Générale n° 6, 8 Février 2016, 147.
[56] TA Cergy-Pontoise, Ordonnance, n° 1600238, 15 janvier 2016/ CE, Ordonnance, n°396348, 1er février 2016.
[57] TA Clermont-Ferrand, Ordonnance n°1600065, 16 janvier 2016/ Conclusion Xavier Domino, sous arrêt CE, 395009, 11 décembre 2015.
[58] CE, Ordonnance, n° 395620, 6 janvier 2016.
[59] Jean Marc Sauvé, Assemblée nationale, Rapport n°3784 enregistré le 25 mai 2016 sur le contrôle parlementaire de l’état d’urgence
[60] Agnès Roblot-Troizier, Assignations à résidence en état d’urgence, Note sous Conseil d’État, Section, 11 décembre 2015, M C. Domenjoud, n° 395009, AJDA 2015. 2463
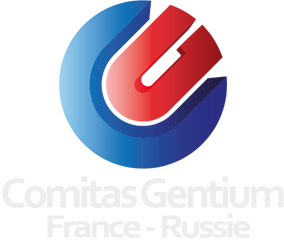



Recent Comments