L’ equivoque presidentielle
Extrait de l’ouvrage « Le consulat Sarkozy », éd. Odile jacob, 2012
Elu président de la République en 2007, Nicolas Sarkozy voulait tuer le job de premier ministre ; à l’arrivée, en 2012, il a seulement abîmé le job de président. Tout avait pourtant bien commencé. En tout cas, tout avait été clairement annoncé. Lors de la campagne présidentielle, le futur vainqueur avait, avec franchise et décomplexions, proclamé qu’il serait un président-leader, un président qui gouverne, un président qui décide. Rompre, disait-il, avec l’immobilisme et le retrait présidentiel des années Chirac marquées par des premiers ministres omniprésents : Alain Juppé de 1995 à 1997, Jean-Pierre Raffarin de 2002 à 2005, Dominique de Villepin de 2005 à 2007 et, bien sûr, Lionel Jospin, le premier ministre qui dirigea seul les affaires du pays pendant cinq ans de 1997 à 2002. Mais aussi, tirer les conséquences politiques du quinquennat. Instauré en 2000, il réduit les possibilités d’une présidence arbitrale en charge du long terme et de la continuité institutionnelle amortissant les évolutions politiques par des changements de premier ministre au moment opportun ; compatible avec une présidence distante, la règle du septennat, soutient déjà Georges Pompidou en 1973, ne l’est plus avec une présidence active qui impose, pour rester démocratique, de se ressourcer à intervalles plus rapprochés au suffrage universel. Donc, cinq ans. Et, en 2007, Nicolas Sarkozy assume cette nouvelle durée : puisque le constituant a ramené le mandat à cinq ans parce que le président de la Vème République n’était plus un arbitre, le président doit donc gouverner lui-même, il ne peut plus se cacher derrière son ou ses premiers ministres, il a l’obligation quasi constitutionnelle de se montrer, d’intervenir dans tous les domaines de la vie politique, d’agir et de décider vite car il aura personnellement à rendre compte de son action aux électeurs et que « cinq ans, c’est court ! ». A ces éléments objectifs, s’ajoute la personnalité de Nicolas Sarkozy ; connaissant depuis longtemps son caractère, son tempérament et son comportement, les Français ne pouvaient à aucun moment penser qu’une fois élu il s’endormirait à l’Elysée dans une présidence tranquille. Ils l’avaient même élu pour qu’il fasse « bouger les lignes », selon une de ses expressions favorites à l’époque.
Et, heureuse coïncidence, si le futur président veut gouverner, le futur premier ministre veut la disparition de Matignon ! Dans un livre écrit en 2006, François Fillon, retrouvant la rhétorique gaullienne contre la dyarchie au sommet de l’Etat, propose la suppression du poste de premier ministre[1]. L’accord semble ainsi parfait entre les deux hommes, le peuple en est témoin et valide par son vote l’unité du couple. L’Exécutif allait, pour la première fois sous la Vème République, marcher de concert, en confiance et sans arrière-pensée, chacun ayant théorisé et intégré sa propre position institutionnelle et celle de l’autre. Là devait être la rupture. Car l’histoire des relations Président/premier ministre est, jusqu’en 2007, un long fleuve constamment agité. Et pas seulement quand ils ne sont pas du même camp politique.
La fidélité incontestable de Michel Debré au général de Gaulle ne saurait faire oublier non seulement les désaccords feutrés sur la politique algérienne mais aussi les différends institutionnels qui conduiront à la rupture d’avril 1962. Après que les électeurs aient massivement approuvé, par le référendum du 8 avril 1962, les accords d’Evian mettant fin à la guerre d’Algérie, le premier ministre propose de dissoudre immédiatement l’Assemblée nationale pour profiter des résultats du référendum et obtenir, dans la foulée, une majorité parlementaire forte, stable et cohérente. Depuis des années, le modèle politique de Michel Debré est le régime primo ministériel britannique qu’il croit avoir introduit en France avec la constitution de 1958. Le général a le même souci de la restauration de l’autorité de l’Etat mais elle ne passe pas par Matignon. Elle passe par l’Elysée. Aussi, obtient-il de son premier ministre qu’il démissionne afin d’affirmer clairement, au moment où toute la classe politique le presse de se retirer à Colombey, qu’il continuera à déterminer seul la politique du pays même après le règlement de « l’affaire algérienne » pour lequel il avait été précisément rappelé au pouvoir.
De Gaulle ne devient pas pour autant un hyper président. Très vite, son nouveau premier ministre, Georges Pompidou, s’impose. Dès 1964, lors d’un grand débat à l’Assemblée nationale, il est celui qui dit – et pas seulement qui porte – la parole politique de la droite contre le député François Mitterrand qui, à la tribune et dans un petit livre incendiaire, vient d’accuser le pouvoir de commettre un coup d’Etat permanent[2]. Mais surtout, après l’élection présidentielle de 1965 qui a bousculé l’image héroïque du général de Gaulle, Pompidou gouverne ; il définit la stratégie politique pour les élections législatives de 1967, décide des investitures, dirige et conduit personnellement la campagne électorale et, à l’issue d’un scrutin gagné de justesse, s’affirme comme le véritable chef du gouvernement et de la majorité parlementaire. Cet ascendant du premier ministre se manifeste pleinement lors de la crise de mai 1968 où c’est lui qui prend toutes les décisions, dirige les négociations dites de Grenelle avec les organisations syndicales, impose au président de la République de renoncer à son projet de référendum qu’il avait pourtant publiquement annoncé, le convainc de recourir à la dissolution et conduit la campagne qui donne au parti gaulliste-pompidolisé la majorité absolue à l’Assemblée. La suite est connue. Pour tenter de réaffirmer la primauté présidentielle, de Gaulle écarte Pompidou, nomme à Matignon son fidèle Maurice Couve de Murville et, par le référendum du 27 avril 1969, demande aux Français de lui accorder personnellement leur confiance. Tentative contrée par Pompidou lui-même qui, de Rome, annonce, le 17 janvier 1969 qu’il sera candidat à l’élection présidentielle « si le général venait à se retirer ». Le référendum est perdu le 27 avril, le général démissionne le 28 et Pompidou est élu président de la République le 15 juin 1969.
Le quinquennat de Georges Pompidou n’est pas davantage marqué par une primauté présidentielle continue et absolue. Sans doute, dans sa première conférence de presse du 10 juillet 1969, le nouveau Président veut faire de son élection le signe de la défaite définitive de la présidence arbitrale : « Je crois que le choix qu’a fait le peuple français démontre son adhésion à la conception que le général de Gaulle a eue du rôle du Président de la République : à la fois chef suprême de l’exécutif, gardien et garant de la Constitution, il est, à ce double titre, chargé de donner les impulsions fondamentales, de définir les directions essentielles et de contrôler le bon fonctionnement des pouvoirs publics. Une telle conception comporte la primauté du chef de l’Etat qui lui vient de son mandat national et qu’il est de son devoir de maintenir ». Mais, de 1969 à 1972, cette primauté est directement concurrencée par le rôle politique « original » revendiqué et assumé par le premier ministre, Jacques Chaban-Delmas. Nommé par le chef de l’Etat, il dispose cependant d’atouts propres qui lui donnent une indépendance de pensée et d’action : président de l’Assemblée nationale pendant dix ans, de 1959 à 1969, il a tissé des liens personnels utiles avec l’ensemble des parlementaires ; gaulliste « de la première heure » – 1940 – il est aussi issu de la famille radicale, a été plusieurs fois ministres sous la IVème République, et manifeste une ouverture d’esprit sur les questions de société ; maire de Bordeaux, il possède une assisse électorale qui lui assure le titre de « duc d’Aquitaine » ; premier ministre d’un Président élu par le droite, il s’entoure à Matignon de conseillers venant de la gauche modérée, chrétienne et syndicale, dont le plus connu est alors Jacques Delors[3]. Chaban n’est pas Couve de Murville. Son existence politique ne dépend pas seulement du Président de la République ; il s’est construit une indépendance électorale, intellectuelle et d’action, et, sur elle, il fonde l’exercice d’un rôle politique original qui le met rapidement en situation de concurrence dangereuse avec Pompidou. Cette autonomie par rapport au Président de la République se manifeste clairement et immédiatement dans la déclaration de politique générale qu’il prononce devant les députés le 16 septembre 1969 et qui apparaît à chacun comme un véritable discours-programme présidentiel. Il y expose, sans en avoir informé préalablement le chef de l’Etat comme le veut la tradition, sa critique de la société française bloquée par la bureaucratie et l’autoritarisme et sa volonté de construire une « nouvelle société » fondée sur la liberté, sur une politique sociale contractuelle, sur le dialogue avec les forces vives, sur la décentralisation, sur la modernisation industrielle et la formation professionnelle. Et, tout en affirmant sa loyauté à l’égard du Président, Jacques Chaban-Delmas, sur la base de son programme, entreprend des réformes : libéralisation de la télévision, mensualisation des salaires, nouveau régime des conventions collectives, négociation de contrats de progrès avec les grandes entreprises, loi sur la formation permanente,… Très vite, cet activisme social du Premier ministre inquiète la majorité parlementaire conservatrice issue des « élections de la peur » de juin 1968 ; les critiques se multiplient à l’encontre d’un Premier ministre qui préfère négocier avec les syndicats plutôt qu’écouter ses députés, qui préfère favoriser l’électorat de gauche plutôt que celui de la majorité… Et, en 1971, les parlementaires gaullistes lancent des appels répétés au Président de la République pour qu’il intervienne, pour qu’il reprenne en main la direction des affaires du pays, bref, pour qu’il gouverne à la place de son Premier ministre. Ce qu’il fait ; mais, en rétablissant ainsi la primauté présidentielle dans la détermination et la conduite de la politique du pays, il provoque une détérioration progressive des rapports entre les deux têtes de l’Exécutif qui se termine par la révocation, le 5 juillet 1972, de Chaban-Delmas. Avec Messmer premier ministre, humble serviteur de l’Etat sans personnalité ni pensée politique propre, la primauté présidentielle semble pouvoir se rétablir ; mais elle manque tous ses effets : le parti gaulliste perd 100 sièges aux élections législatives de mars 1973 et les giscardiens deviennent un élément indispensable à la formation de la majorité gouvernementale ; le projet présidentiel de réduction du mandat présidentiel à cinq ans échoue en octobre 1973 ; et, dernier signe du déclin présidentiel[4], le chef de l’Etat perd le contrôle de son parti qui, au congrès de Nantes en novembre 1973, élimine ses partisans de la direction au profit des amis de Jacques Chaban-Delmas qui reçoit, un an après avoir été évincé, un accueil triomphal !
Les relations tumultueuses du couple Giscard/Chirac constituée en 1974 ont marqué la vie politique française pendant plus de trente ans et se poursuivaient encore ces dernières années autour de la table du Conseil constitutionnel. Là aussi, tout avait pourtant bien commencé. Avec 43 députés gaullistes, Jacques Chirac avait apporté son soutien à la candidature de Valéry Giscard d’Estaing et contribué ainsi à sa victoire sur Jacques Chaban-Delmas au premier tour de la présidentielle de 1974 et sur François Mitterrand au second. En retour, élu président, VGE nommait Chirac premier ministre. Colossale erreur ! Car, si les gaullistes sont, un temps, déstabilisés par la perte de l’Elysée et laissent le nouveau président gouverner – majorité électorale à 18 ans, IVG, … – très vite ils font bloc derrière le premier ministre qu’ils élisent secrétaire général de l’UDR en décembre 1974. Commence alors une guérilla où Jacques Chirac, disposant à l’Assemblée d’un nombre de députés toujours supérieur à celui des députés giscardiens, conteste la primauté présidentielle : démission violente de Matignon le 25 août 1976[5], création du RPR en décembre 1976, prise de la mairie de Paris en 1977 après une bataille acharnée contre le giscardien Michel d’Ornano, refus de voter le budget en 1979 et, bien sûr, candidature à la présidentielle de 1981 sur un positionnement politique critique qui contribuera à la défaite de VGE.
Paradoxalement, François Mitterrand, qui avait brillamment dénoncé le pouvoir personnel dans Le Coup d’Etat permanent, rétablit l’autorité de la fonction présidentielle par la grâce de dissolutions qui, en 1981 et 1988, lui donnent une majorité parlementaire qui le reconnait comme son chef. Mais, sur ces quatorze années de mandat, il n’a été un hyper président que cinq ans, de 1981 à 1986 ; et encore, en 1983, le rôle du premier ministre Pierre Mauroy et du ministre du budget Jacques Delors a été décisif pour convaincre le président de la République, qui en était tenté, de ne pas sortir la France du système monétaire européen. Président relatif de 1988 à 1991 quand le premier ministre Michel Rocard assure, sauf en politique étrangère, la conduite des affaires du pays, président désaccordé de 1991 à 1993 quand il est contraint de remplacer Edith Cresson par Pierre Bérégovoy un an seulement après l’avoir nommée à Matignon, François Mitterrand est surtout le premier président de la République à avoir accepté que le pouvoir de gouverner la France passe totalement entre les mains du premier ministre. Conséquence logique de son acceptation de la cohabitation. Ayant perdu les élections législatives de mars 1986, il aurait pu, à la manière d’un Charles de Gaulle quittant le pouvoir après l’échec du référendum d’avril 1969, démissionner. Il choisit de rester et de se soumettre à la nouvelle majorité parlementaire en nommant son chef, Jacques Chirac, premier ministre. La Vème République devient VIème République. Ou, plus exactement, elle devient ce qu’elle est « dans le texte », primo-ministériel : conformément aux articles 20 et 21 de la constitution, le premier ministre détermine et conduit la politique de la Nation et, conformément à l’article 5, François Mitterrand veille au bon fonctionnement des institutions. Au demeurant, ce partage ne lui est pas défavorable puisque, utilisant avec habileté cette position d’arbitre, il reconquiert l’opinion et bat Jacques Chirac à l’élection présidentielle de 1988. Cette première expérience de cohabitation se renouvelle en 1993 après la lourde défaite des socialistes aux élections législatives de mars : 282 à la veille des élections, les députés socialistes ne sont plus que 67 après ! Mais, à nouveau, François Mitterrand reste à l’Elysée et laisse Edouard Balladur gouverner comme il l’entend pour se consacrer, de 1993 à 1995, à ses affaires personnelles – son cancer, son passé et ses amitiés vichyssois, sa fille et ses familles, … – et à ses adieux aux grands de ce monde. En 1995, le pouvoir n’est plus à l’Elysée, il est à Matignon.
Et il ne revient pas à l’Elysée avec Jacques Chirac. Elu avec 52% des voix le 7 mai 1995, disposant du soutien de la majorité parlementaire issue des élections de mars 1993, bénéficiant du soutien du Sénat, il avait pourtant les moyens de rétablir l’autorité présidentielle. Mais il laisse gouverner son premier ministre, Alain Juppé, qui conçoit et conduit avec une rudesse certaine – le fameux « je suis droit dans mes bottes » – la réforme des retraites et de la sécurité sociale provoquant à l’automne 1995 une grave crise sociale, une impopularité du gouvernement, une perte de confiance du Président dans l’opinion et d’autorité au sein de son propre camp. Avec, pour sortir de cette situation, la dissolution du 21 avril 1997 qui fait la gauche majoritaire à l’Assemblée nationale et oblige Jacques Chirac à nommer premier ministre Lionel Jospin, celui-là même qu’il avait battu deux ans plus tôt à l’élection présidentielle ! Et donc, de 1997 à 2002, le pouvoir s’installe à Matignon. Les 35h, le PACS, la couverture mutuelle universelle, la parité, le quinquennat sont l’œuvre du gouvernement Jospin qui, à la différence des premiers ministres des cohabitations précédentes, bénéficie de la durée – cinq ans – et d’un Président affaibli. Contesté par une partie de ses amis pour les avoir conduits à la défaite et atteint par les affaires politico-financières de la mairie de Paris, Jacques Chirac ne sera jamais en position de jouer le rôle qu’avait pu être celui de François Mitterrand lors de la première cohabitation. Et pourtant, lui aussi, va sortir vainqueur de cette cohabitation en gagnant la présidentielle de 2002 après le choc politique de l’élimination de Lionel Jospin dès le premier tour. Sans pour autant rétablir l’autorité de la fonction présidentielle. Contesté par Nicolas Sarkozy qui s’empare de l’UMP et porte tout au long du quinquennat sa petite musique critique, Jacques Chirac consent, en 2005, à son propre affaiblissement en laissant gouverner son premier ministre Dominique de Villepin afin qu’il fasse la démonstration de sa capacité à diriger le pays et ruine ainsi les prétentions élyséennes de Nicolas Sarkozy. Avec le succès que chacun sait !
Contrairement à une opinion convenue, la Vème République n’est donc pas le régime de l’hyper présidence. Au cours de chacun des mandats présidentiels, l’autorité du chef de l’Etat a varié selon la nature des questions politiques – internationales ou internes – et surtout selon la qualité de la majorité parlementaire et les caractères des hommes. De Gaulle, Pompidou, Giscard d’Estaing, Mitterrand et Chirac ont, chacun et tour à tour, été des présidents forts et des présidents concurrencés par leur premier ministre.
[1] François Fillon, La France peut supporter la vérité, Albin Michel, 2006.
[2] François Mitterrand, Le Coup d’Etat permanent, Plon, 1964.
[3] Qui deviendra en 1981 ministre de François Mitterrand…
[4] A ces échecs, il faut ajouter la maladie de Pompidou qui, durant l’automne et l’hiver 1973, déclenche, dans la presse et la classe politique, des rumeurs de démission et de pré-campagne électorale qui contribuent encore à affaiblir l’autorité du chef de l’Etat.
[5] « Je ne dispose pas des moyens que j’estime aujourd’hui nécessaires pour assumer mes fonctions de premier ministre » déclare Jacques Chirac pour justifier sa démission.
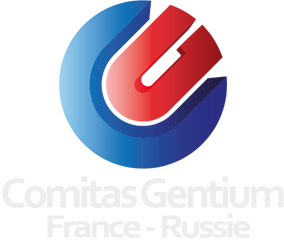



Recent Comments