L’articulation du droit international et du droit national: situation en France en 2016
Cette situation pourrait sans doute être résumée en deux phrases : le statut constitutionnel des engagements internationaux de la France paraît aujourd’hui stabilisé. En revanche, les interférences de juridictions créées par certains engagements internationaux de la France sur le contenu et l’application du droit interne français peuvent encore poser problème.
I- le statut constitutionnel des engagements internationaux
Dès le XIXè siècle la doctrine française a largement défendu la conception « moniste » de l’articulation du droit international et du droit interne, à la différence de la conception « dualiste » adoptée notamment en Grande Bretagne.
Ainsi, à la suite d’ailleurs d’auteurs allemands, Carré de Malberg[1] a en 1920 rappelé les objections d’ordre pratique et théorique au système qui prétend séparer les deux questions de validité externe et d’exécution interne des traités. Il a notamment fait valoir qu’en spécifiant que les traités qu’elle subordonne à un vote parlementaire « ne sont définitifs qu’après avoir été votés par les deux chambres », la Constitution de 1875 avait consacré le système moniste,la formule même utilisée impliquant que l’assentiment des chambres est nécessaire pour la perfection du traité au point de vue international et non pas seulement pour son efficacité au point de vue interne.
En pratique, les juridictions suprêmes des deux ordres, Cour de cassation et Conseil d’Etat ont fait sans difficulté sous la troisième République application directe à un requérant qui s’en prévalait de certains traités régulièrement ratifiés et publiés au journal officiel tels que des traités concernant le droit d’établissement en France de ressortissants étrangers, ou tendant à éviter des doubles impositions . Il en allait ainsi même si la stipulation en cause du traité n’était pas compatible avec une loi interne antérieure, le juge s’appuyant implicitement dans ce cas sur l’adage lex posterior derogat priori.
En revanche, d’une part le juge national ne se reconnaissait pas le pouvoir d’interpréter le traité en cas de contestation sérieuse et prononçait donc un sursis à statuer jusqu’à ce que le ministre des affaires étrangères ait donné son interprétation laquelle s’imposait alors à lui. D’autre part, il ne se reconnaissait pas le pouvoir d’écarter la loi postérieure au profit du traité, en vertu de la tradition politique et juridique remontant à la Constitution de 1791 « Il n’y a point, en France, d’autorité supérieure à celle de la loi ».
Depuis 1946 la pensée politique suscitée par la seconde guerre mondiale sur la place à faire aux engagements internationaux a conduit à des novations successives dans les textes constitutionnels français.
En premier lieu, le préambule de la Constitution de 1946- qui fait partie du corpus constitutionnel toujours en vigueur – dispose « La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. Elle n’entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n’emploiera jamais ses forces contre la liberté d’aucun peuple. Sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l’organisation et à la défense de la paix ».
En second lieu, dans son texte d’origine toujours en vigueur sur ce point, la Constitution actuelle du 23 octobre 1958 énonce à l’article 55 « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie ». La Constitution déclare donc pour la première fois que la loi n’est pas l’autorité suprême dans l’ordre interne.
En troisième lieu, deux séries de modifications ultérieures de la Constitution de 1958 ont déjà eu des répercussions importantes sur l’articulation du droit international et du droit interne.
Il s’agit d’abord de l’accroissement à deux reprises du rôle conféré au Conseil Constitutionnel : en 1974 en ce qui concerne le contrôle a priori de la constitutionnalité de la loi par l’élargissement de ses conditions de saisine à 60 députés ou sénateurs, arme juridique ainsi accordée à l’opposition parlementaire, puis en 2008 par l’introduction dans le système juridictionnel français d’une question prioritaire de constitutionnalité.
Il s’agit ensuite de 6 lois constitutionnelles qui traitent d’engagements internationaux.
L’une, du 25 juin 1992 et insérée à l’article 54 de la Constitution, a une portée très générale. Elle dispose en effet « Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier ministre, par le président de l’une ou l’autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de ratifier ou d’approuver l’engagement international en cause ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution ».
Les autres, respectivement du 27 juillet 1993, du 25 novembre 1993, du 8 juillet 1999, du 4 février 2008 et du 23 juillet 2008 et insérées au titre VI de la Constitution intitulé « Des traités et accords internationaux » ou au titre XV intitulé « De l’Union européenne » ont eu pour but soit de permettre la reconnaissance de la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé par la France le 18 juillet 1998, soit de conférer une base constitutionnelle à certains engagements internationaux liés à la construction d’une entité politique européenne.
Notamment, l’article 88-1 – dont l’origine remonte à la loi constitutionnelle du 25 juin 1992 provoquée par la signature le 7 février 1992 du traité de Maastricht – énonce, dans sa rédaction actuellement en vigueur adoptée en février 2008, « La République participe à l’Union européenne constituée d’Etats qui ont choisi librement d’exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l’Union Européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tels qu’ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 ».
Les juridictions françaises ont tiré les conséquences de l’évolution des textes constitutionnels depuis 1958 en reconnaissant la primauté du traité sur la loi mais en affirmant l’ absence de primauté des traités sur la Constitution dans l’ordre interne.
La reconnaissance de la primauté du traité sur la loi
Dans un premier temps,le Conseil constitutionnel,saisi par des députés afin de voir déclarer certaines dispositions de la loi sur l’interruption volontaire de grossesse non conformes à l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme qui dispose notamment que « le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi », a jugé dans une décision du 15 janvier 1975[2] que si les dispositions de l’article 55 de la Constitution confèrent aux traités une autorité supérieure à celle des lois, il ne lui appartient pas « d’examiner la conformité d’une loi aux stipulations d’un traité ou d’un accord international ». Autrement dit, le Conseil constitutionnel admet implicitement qu’une loi contraire à un traité ne serait pas pour autant contraire à la Constitution.
Dans un deuxième temps, la Cour de Cassation dans un arrêt du 24 mai 1975 Jacques Vabre[3], a estimé que cette décision du Conseil constitutionnel permettait de considérer que si elles écartent une loi même postérieure au profit d’un traité, les juridictions ordinaires ne s’instituent pas pour autant juges de la constitutionnalité des lois. Abandonnant donc sa jurisprudence traditionnelle selon laquelle le devoir du juge était de ne pouvoir connaître « d’autre volonté que celle de la loi »[4], la Cour de cassation a reconnu dans cette affaire la primauté du droit de l’Union européenne sur le droit français, posée par ailleurs en principe dès 1964 par la Cour de justice des communautés européennes[5].
Dans un troisième temps, le Conseil d’Etat, dans un arrêt Nicolo du 20 octobre 1989[6] s’est fondé sur l’article 55 de la Constitution pour revenir sur sa jurisprudence antérieure réaffirmée en 1968 et appliquer les dispositions d’ une loi de 1977 relative à l’élection des représentants à l’Assemblée des communautés européennes, après avoir affirmé qu’elles n’étaient pas incompatibles avec les dispositions du traité de Rome de 1957.
Dans la suite de ces arrêts de principe, les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif ont également écarté l’application d’une loi postérieure contraire à une norme relevant du droit dérivé de l’Union européenne, qu’il s’agisse de règlements,de directives ou de décisions.
Par ailleurs, le Conseil d’Etat, abandonnant en 1990 sa jurisprudence antérieure, a jugé qu’il n’est pas tenu de renvoyer au ministre des affaires étrangères une disposition conventionnelle dont le sens n’est pas clair et que s’il a néanmoins estimé utile de recueillir les observations de ce ministre sur ce point, il n’est pas tenu de s’incliner devant l’interprétation de ce dernier. En revanche, il a jugé en 1999 que si le non respect de la condition de réciprocité prévue par l’article 55 de la Constitution était soulevé par l’une des parties au litige, en cas de doute il devait saisir à titre préjudiciel le ministre des affaires étrangères.
Il a également, en 1998, accepté de contrôler le respect par l’exécutif des dispositions constitutionnelles qui exigent que, pour certains traités tels ceux qui modifient des dispositions législatives, la ratification soit autorisée par le Parlement.
En 2000, il a posé en principe que « dans le cas de concours de plusieurs engagements internationaux, il y a lieu d’en définir les modalités d’application respectives conformément à leurs stipulations et en fonction des principes du droit coutumier relatifs à la combinaison entre elles des conventions internationales », ce qui renvoie implicitement à la convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités.
Il a par ailleurs jugé en 1997 que ni l’article 55 de la Constitution, ni aucune autre disposition constitutionnelle « ne prescrivent ni n’impliquent » que le juge administratif fasse prévaloir la coutume internationale sur la loi en cas de conflit entre ces deux normes » et en 2000 a adopté un raisonnement identique pour la combinaison de la loi et des principes généraux du droit international.
Si, contrairement à la Cour de cassation, le Conseil d’Etat refuse de relever d’office la méconnaissance d’une règle ou d’un principe issu du droit communautaire,il a en revanche jugé en 1992 que la responsabilité de l’Etat était engagée par l’illégalité de décisions individuelles prises sur le fondement de dispositions règlementaires mettant en œuvre une loi incompatible avec les objectifs d’une directive communautaire[7]. Il a même jugé en 2009 qu’il appartient au juge national de garantir l’effectivité des droits à l’égard des autorités publiques que toute personne tient de l’obligation de transposer en droit interne les directives communautaires, l’effet direct de la directive restant néanmoins subordonné au défaut de sa transposition dans le délai prévu et au caractère inconditionnel et suffisamment précis de la disposition en cause[8].
Quant au Conseil constitutionnel, en se fondant sur la disposition de l’article 88-1 de la Constitution selon laquelle la République participe à l’Union européenne « constituée d’Etats qui ont choisi librement d’exercer en commun certaines de leurs compétences », il admet de censurer comme violant cet article une disposition législative « manifestement incompatible avec la directive qu’elle a pour objet de transposer »[9]. En revanche, il s’interdit de censurer comme inconstitutionnelle une loi qui transpose des dispositions inconditionnelles et précises d’une directive,car cela reviendrait à examiner la constitutionnalité de la directive ce qui est exclu[10]. Il a également précisé que l’exigence constitutionnelle de transposition des directives ne saurait être invoquée dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité[11].
A noter enfin que le principe actuel selon lequel le traité prévaut sur la loi même postérieure conduit le juge à s’interroger plus fréquemment sur le point de savoir si la stipulation du traité invoquée par une partie au litige devant lui doit être reconnue d’effet direct. Le principe ,tel qu’énoncé par le Conseil d’Etat dans un arrêt de 2012 est qu’une stipulation doit être reconnue d’effet direct « lorsqu’eu égard à l’intention exprimée par les parties et à l’économie générale du traité invoqué, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, elle n’a pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requiert l’intervention d’aucun acte complémentaire pour produire des effets à l’égard des particuliers »[12]
L’absence de primauté des traités sur la Constitution dans l’ordre interne
La Constitution de 1958, dans l’ article 55 d’origine et dans l’ article 88-1issu de la révision de 1992, est le fondement mais constitue les limites des évolutions de jurisprudence décrites plus haut.
Aussi en 1998 le Conseil d’Etat a jugé que la primauté des traités sur les lois « ne s’applique pas, dans l’ordre interne, aux dispositions de nature constitutionnelle » [13]et en 2000 la Cour de cassation a posé le même principe[14]. D’ailleurs dès 1986, une décision du Tribunal des conflits[15] avait déjà implicitement retenu cette solution en jugeant que la liberté d’aller et venir y compris de quitter le territoire national reconnue par la déclaration de 1789, élément du corpus constitutionnel français, n’avait été que « confirmée » par la convention européenne des droits de l’homme.
De son coté, le Conseil constitutionnel considère d’une part que l’article 88-1 exprime la reconnaissance par le pouvoir constituant à la fois de « l’acquis communautaire » et de la portée constitutionnelle de la participation de la France à la construction européenne mais, d’autre part, que le principe de primauté du droit communautaire découlant des traités ne saurait conduire dans l’ordre interne à remettre en cause la suprématie de la Constitution. D’où son affirmation fondamentale que « la transposition en droit interne d’une directive communautaire résulte d’une exigence constitutionnelle mais ne saurait aller à l’encontre d’une règle ou d’un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le Constituant y ait consenti ».[16]
On a donc pu écrire que c’est « sous pavillon constitutionnel » que les juges français ont été de plus en plus amenés à faire produire ses effets au droit de l’Union européenne.
Il serait cependant erroné de croire que le cadre constitutionnel mis en place depuis 1958 suffit à garantir en France pour l’avenir une parfaite articulation entre droit international et droit interne. Ce serait en effet oublier qu’en vertu tant des traités successivement conclus pour la construction des Communautés européennes puis de l’Union européenne que de la convention européenne des droits de l’homme, des juridictions non nationales peuvent interférer dans le processus juridictionnel français ainsi que dans le contenu et l’application du droit interne. Leurs interférences peuvent donc être source de problèmes juridiques spécifiques.
II- Les interférences sur le droit interne de juridictions créées par des engagements internationaux auxquels la France est partie
Ces interférences présentent des caractéristiques différentes selon qu’il s’agit de la Cour de justice des communautés européennes devenue Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) par l’effet du traité de Maastricht entré en vigueur en 1993 ou de la Cour européenne des droits de l’homme(CEDH).
L’ interférence de la CJUE sur le processus juridictionnel français
Dès l’institution de la communauté économique européenne en 1957, le traité de Rome a prévu que la Cour de justice qu’il créait serait compétente notamment pour statuer à titre préjudiciel sur l’interprétation du traité et sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions de la Communauté, en précisant que lorsqu’une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction « est tenue de saisir la Cour de justice ».
En 1964 le Conseil d’Etat avait manifesté, par tentation d’autarcie, la volonté d’éviter les renvois préjudiciels à la Cour de justice en maniant la théorie de l’acte clair[17]. A partir des années 1990 cette théorie a néanmoins été abandonnée avec l’approfondissement juridique de la construction européenne[18]. La volonté des juridictions françaises d’être le « juge de droit commun » de l’application du droit de l’Union européenne et le souci de « dialogue des juges » ont donc conduit au développement des questions préjudicielles à la CJUE.
De plus, depuis 2006 le Conseil d’Etat juge « qu’alors même qu’elle ne faisait pas l’objet du renvoi préjudiciel,l’interprétation du traité et des actes communautaires que la Cour(CJUE) était compétente pour donner…s’impose au Conseil d’Etat ».
Plus significative encore est la jurisprudence Arcelor.
Dans un premier arrêt du 8 février 2007, le Conseil d’Etat déduit des dispositions de l’article 88-1 de la Constitution que dans le cas où sont transposées des dispositions précises et inconditionnelles d’une directive, il appartient au juge administratif, s’il est saisi d’un moyen tiré de la méconnaissance par le décret de transposition d’une disposition ou d’un principe de valeur constitutionnelle, de rechercher s’il existe une règle ou un principe général du droit communautaire qui, eu égard à sa nature et à sa porté, tel qu’il est interprété en l’état actuel de la jurisprudence du droit communautaire, garantit par son application l’effectivité du respect de la disposition ou du principe constitutionnel invoqué.
Estimant qu’en l’espèce le principe général du droit communautaire d’égalité garantissait l’effectivité du respect du principe constitutionnel invoqué, il a donc accepté de contrôler la constitutionnalité du décret attaqué par le biais du contrôle de validité de la directive transposée et,ayant constaté l’existence d’une difficulté sérieuse, il a saisi la CJUE de la question de savoir si était ou non objectivement justifiée la différence de traitement instituée par la directive litigieuse.
Par un arrêt du 16 décembre 2008 la Cour de justice, statuant sur la question préjudicielle, a reconnu la validité de la directive de telle sorte que, dans son arrêt du 3 juin 2009, après avoir relevé qu’il résultait de l’arrêt de la Cour de justice « que la directive, dont le décret attaqué assure la transposition,ne méconnait pas le principe communautaire d’égalité », le Conseil d’Etat a jugé « qu’il s’en suit que le moyen tiré de la méconnaissance par ce décret du principe constitutionnel d’égalité ne saurait qu’être écarté ».
L’introduction par la réforme constitutionnelle de 2008 d’une possibilité de contrôle a posteriori de la constitutionnalité des lois par la procédure de la question prioritaire de constitutionnalité a conduit à mettre à nouveau en évidence les effets de la compétence de la CJUE sur le fonctionnement du système juridictionnel français.
Ainsi, l’adoption par le conseil européen le 13 juin 2002, sur le fondement des dispositions du traité de 1992 sur l’Union européenne relatives à la coopération policière et judiciaire en matière pénale, d’une décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen a conduit à un « partage de rôles » assez spectaculaire entre juridictions nationales et juridiction européenne.
En effet, le 27 février 2013 le Conseil constitutionnel est saisi par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article 645-46 du code de procédure pénale en ce qu’il prévoit une absence de recours en cas d’extension des effets du mandat d’arrêt européen par la chambre d’instruction.
Le 4 avril 2013, il saisit la CJUE d’une question préjudicielle sur l’interprétation de la décision cadre du 13 juin 2002. Le 30 mai 2013 celle-ci déclare que cette décision-cadre ne s’oppose pas à ce que les Etats membres organisent un recours contre la décision de la chambre d’instruction, ce qui permet au Conseil constitutionnel de juger le 14 juin 2013 que l’absence de recours prévu par l’article 695-46 du code de procédure pénale viole le droit à exercer un recours juridictionnel effectif tel que protégé par la Constitution[19].
Dans la même ligne, en 2015 le Conseil d’Etat a jugé[20] qu’il n’ya pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel une question portant sur une disposition législative se bornant à tirer les conséquences nécessaires de dispositions précises et inconditionnelles d’une directive,en l’absence de mise en cause d’une règle ou d’un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France. Il s’est donc aligné sur la position exprimée par le Conseil constitutionnel dans ses décisions précitées de 2004 et 2006, ce qui met ainsi en évidence que dans le champ d’application du droit de l’Union européenne, le contrôle de constitutionnalité des lois et règlements a en fait vocation à n’être que résiduel en l’état de la jurisprudence.
C’est sans doute là une des conséquences d’un double fait.
D’une part, dès l’origine en 1957, la construction d’une communauté économique européenne devenue Union européenne à compter de 1993 a largement reposé sur la « fonction d’éclaireur » conférée à une Cour de justice dotée d’une compétence exclusive pour l’interprétation et l’appréciation de validité du droit dérivé émis par les autorités prévues par les traités.
D’autre part, le développement de la production normative communautaire, au surplus destinée à être appliquée dans un nombre croissant d’Etats membres de traditions juridiques différentes, a conduit à ce que les directives, qui ne devaient au départ lier les Etats membres que « quant au résultat à atteindre » en laissant les autorités nationales seules compétentes pour décider de la forme à donner à leur exécution ,sont de plus en plus souvent devenues des dispositions précises et inconditionnelles dont la transposition obligatoire ne laisse plus de marge d’initiative aux autorités nationales, de telle sorte que les directives font partie de ce qui est aujourd’hui couramment appelé la « législation européenne »[21] .
Sur ces deux points, la situation juridique née pour la France de sa ratification en 1974 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe à Rome le 4 novembre 1950 est évidemment différente. D’une part, si cette convention a ultérieurement été complétée par une quinzaine de protocoles, elle n’a pas créé d’institutions ayant compétence pour élaborer des normes constitutives d’un ordre juridique dérivé de la convention. D’autre part, l’organe juridictionnel qu’elle a créé sous forme d’une Cour européenne des droits de l’homme(CEDH) n’a pas une compétence exclusive pour interpréter la convention et ses protocoles, cette compétence restant partagée avec les juridictions nationales des Etats membres . Il convient donc d’y regarder de plus près.
L’interférence de la CEDH sur le droit français
L’activité effective de la CEDH a été, par le traité de 1950, subordonnée à l’acceptation expresse par l’Etat partie de la compétence de la Cour à recevoir des requêtes individuelles après épuisement des recours internes. C’est ainsi que si depuis sa ratification en 1974 la convention de 1950 est d’application directe en France et a donné lieu à une abondante jurisprudence que ce soit devant le juge judiciaire ou devant le juge administratif, ce n’est qu’en 1981 que la France a accepté la compétence de la Cour européenne et ce n’est en fait qu’a compter de l’arrêt Bozano c/France rendu en 1986[22] qu’une jurisprudence de la CEDH concernant la France s’est développée.
Par ailleurs, entre 1990 et 2007, de nombreux Etats d’Europe de l’est ont adhéré au Conseil de l’Europe en ratifiant la convention et acceptant la juridiction de la Cour. C’est donc pour 47 Etats que la CEDH est devenue un lieu de rencontre juridictionnel, c’est-à-dire pour des Etats qui ont connu des histoires politiques et peuvent avoir des cultures juridiques assez différentes. Or l’objet même de la convention et de ses protocoles – sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales – est si vaste qu’il a de fait conduit à ce que le mécanisme de la requête individuelle soit massivement utilisé et à ce que la jurisprudence de la Cour, souvent compromis inévitable entre les traditions différentes des juges, ne soit pas toujours facilement acceptée par les Etats parties à la convention.
On en donnera comme exemple concret pour la France l’appréciation portée par la CEDH sur certaines caractéristiques de juridictions nationales au regard du droit à un procès équitable tel qu’il est défini par l’article 6-1 de la convention
La procédure devant les juridictions judiciaires et administratives françaises a en effet donné lieu à plusieurs décisions de la Cour de 1998 à 2006 condamnant la France pour violation des dispositions de l’article 6-1 de la convention relatif au droit à un procès équitable[23].
La Cour de cassation s’est ralliée à la jurisprudence européenne dans un arrêt du 30 mai 2002 sur le fait que l’absence de communication au requérant des conclusions de l’avocat général constituait une violation de l’article 6-1 de la convention et a modifié sa procédure interne en ce sens.
En ce qui concerne les juridictions administratives, un décret du 1er août 2006 a retenu une solution transactionnelle : le rapporteur public qui s’est exprimé à l’audience ne doit pas être présent au délibéré de la formation de jugement, mais cette solution ne vaut pas pour le Conseil d’Etat, juridiction administrative suprême, sauf demande contraire d’une partie. Ce traitement différencié a été validé en 2007 par le Conseil d’Etat statuant au contentieux, puis par un arrêt de la Cour européenne en 2009[24].
Par ailleurs, alors même qu’aux termes de la convention les arrêts de la Cour n’ont que l’autorité relative de la chose jugée et ne s’imposent donc qu’à l’Etat qui a été condamné par la Cour pour violation de la convention, [25] la France a jugé prudent de modifier par un décret du 6 mars 2008 la composition de certaines formations de jugement du Conseil d’Etat pour tenir compte de l’ arrêt du 18 septembre 1995 Procola c/Luxembourg.
La CEDH avait en effet censuré, au regard de l’exigence de tribunaux indépendants et impartiaux, le fait qu’un même organe partiellement composé des mêmes membres puisse connaître d’un même acte administratif successivement comme organe consultatif avant son entrée en vigueur puis comme juge administratif.
Ce dossier peut donc être regardé comme ayant été clos,au moins provisoirement, grâce à un suffisant « dialogue des juges ».
Une question délicate a été celle de la possibilité de réouverture des procédures juridictionnelles internes après condamnation de la France par la Cour.
Par sa décision du 30 juillet 2014[26], le Conseil d’Etat, sans revenir sur sa jurisprudence antérieure selon laquelle il n’appartient pas au juge administratif de remettre en cause une procédure juridictionnelle définitivement close, a jugé que lorsque la violation constatée par la Cour concerne une sanction administrative devenue définitive, ce constat d’une méconnaissance des droits garantis par la Convention constitue un élément nouveau qui doit être pris en considération par l’autorité investie du pouvoir de sanction. Il en déduit qu’il incombe à cette autorité, lorsqu’elle est saisie d’une demande en ce sens et que la sanction prononcée continue de produire des effets, d’apprécier si la poursuite de l’exécution de cette sanction méconnaît les exigences de la Convention. Dans ce cas, l’auteur de la sanction administrative peut y mettre fin, en tout ou en partie, eu égard aux intérêts dont elle a la charge, aux motifs de la sanction et à la gravité de ses effets ainsi qu’à la nature et à la gravité des manquements constatés par la Cour.
De son côté, la Cour de cassation juge également que « l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dont il résulte qu’un jugement rendu en matière civile et devenu définitif a été prononcé en violation des dispositions de la Convention n’ouvre aucun droit à réexamen de la cause »[27].
Toutefois, en matière pénale, la loi du 15 juin 2000 a institué une « Commission de réexamen » qui examine les demandes faites « au bénéfice de toute personne reconnue coupable d’une infraction lorsqu’il résulte d’un arrêt rendu par la CEDH que la condamnation a été prononcée en violation des dispositions de la Convention (…), dès lors que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne pour le condamné des conséquences dommageables auxquelles « la satisfaction équitable » allouée sur le fondement de l’article 41 de la Convention ne pourrait mettre un terme ». Cette voie de recours extraordinaire permet, le cas échéant, une réouverture du procès pénal.
Il est certain qu’au delà des décisions condamnant la France, la jurisprudence de la CEDH a contribué à faire évoluer sur de nombreux points le droit français, tant public que privé et tant législatif et règlementaire que jurisprudentiel[28]. En effet, ce que la Cour a jugé à propos de la conventionnalité du système juridique d’un Etat ne peut pas, en fait, être définitivement ignoré par les autres Etats parties à la convention.
Il est en outre à remarquer qu’au moins jusqu’ici aucune disposition législative ou règlementaire prise en conséquence d’un arrêt de la CEDH condamnant la France n’a, semble t-il, donné lieu, selon le cas devant le Conseil constitutionnel ou devant le juge administratif, à contestation de sa constitutionnalité pour incompatibilité entre l’interprétation de la convention donnée par la CEDH et une disposition de portée constitutionnelle.
Cela dit, si elle peut être un ultime recours permettant de sanctionner des violations flagrantes des droits et libertés énoncées dans la Convention,ce pour quoi elle a été conçue en 1950, la Cour doit sans doute, comme les réactions politiques négatives de plusieurs Etats membres du Conseil de l’Europe à certaines jurisprudences l’ont déjà montré, résister à la tentation, d’exercer en substance une justice constitutionnelle pour 47 Etats,au hasard de recours individuelsparfois motivés par des stratégies politiques nationales. Sa légitimité ne procède en effet que d’un traité international et non d’un pouvoir constituant.
Il reste qu’un apport particulièrement fécond de la Cour a été de juger que les droits et libertés définis par la convention ne devaient pas être considérés que comme des protections du citoyen contre l’arbitraire de l’Etat mais devaient également régir les rapports, dits « horizontaux » entre particuliers. Celà a, par exemple, conduit la Cour de cassation à confirmer le rejet d’une demande de résiliation d’un bail d’habitation pour non respect par le locataire, qui avait hébergé ses parents dans les lieux loués, d’une clause d’habitation personnelle stipulée dans le contrat. La Cour de cassation a en effet considéré que la clause était contraire à l’article 8-1 de la convention sur le droit au respect de la vie privée et familiale[29].
* * *
En conclusion deux remarques :
L’article 53 de la Constitution de 1958[30]est une garantie de cohérence possible entre ordre juridique international et ordre juridique interne dans la mesure où, prenant acte de la multiplicité des domaines actuels d’engagements internationaux, il consacre une fois de plus la nécessaire implication du pouvoir législatif dans l’acceptation de ces engagements, constamment affirmée depuis la première constitution écrite française du 3 septembre 1791. Il devrait ainsi dissuader le pouvoir exécutif d’accepter une clause d’application provisoire d’un traité dès sa signature alors que le Parlement pourrait,ou même devrait en cas d’incompatibilité avec un principe de portée constitutionnelle, ne pas l’autoriser à le ratifier.
Si les conditions d’application en France de normes « d’origine européenne » sont aujourd’hui solidement définies par le pouvoir constituant et par les juridictions suprêmes, il reste que la complexité des réseaux juridiques qui en résultent a pour contrepartie une certaine lassitude à l’égard de l’Europe, qu’il s’agisse de celle rêvée à Rome en 1950, ou de celle imaginée … toujours à Rome en 1957. Comme le remarquait Soljenitsyne dans une conférence prononcée à Harvard en 1978 « lorsque toute la vie est pénétrée de rapports juridiques, il se crée une atmosphère de médiocrité morale qui asphyxie les meilleurs élans de l’homme ». Le droit ne suffit pas à définir une politique…
[1] Carré de Malberg, Contribution à la théorie générale de l’Etat,1920, librairie de la société du recueil Sirey, tome I, p. 541 à 546
[2] CC. n°74-54 DC, Dalloz, 1975, jur. P. 529
[3] Dalloz, 1975, jur. P. 497, concl. A.Touffait, AJDA, 1975, p. 567, note J.Boulouis
[4] Cf. concl du procureur général Matter sous cass. civ. 22 décembre 1931, Sirey, 1932 I 261
[5] CJCE, 15 juillet 1964, 6/64, Costa c/Enel, Rec. CJCE, 1964, p. 1141, concl. M. Lagrange
[6] CE ass., 20 octobre 1989, Nicolo, JCP, 1989, II, 21371, concl. Frydman
[7] CE ass., 28 février 1992, Société Arizona Tobacco, rec. P.78
[8] CE ass., 30 octobre 2009, Mme Perreux
[9] CC 27 juillet 2006 n°2006-540 DC, rec. P. 88
[10] CC 10 juin 2004 n° 2004-496 DC, rec. P. 101
[11] CC12 mai 2010 n° 2010-605 DC, JO. 13 mai 2010, p. 8897
[12] CE ass. 11 avril 2012, GISTI et Fapil, AFDI, 2013, p. 588
[13] CE ass. 30 octobre 1998, Sarran, RDP, 1999, p.919, note J-Fr Flauss ; RDTciv, 1999, p. 232, note N.Molfessis
[14] Cass. ass. plen. 2 juin2000, Dalloz, 2000, jur. p. 865, note B.Mathieu et M.Verpeaux
[15] TC 9 juin 1986, Eucat c/Trésorier général du Bas Rhin
[16] CC 10 juin 2004, 2004-496, rec. P. 101 à propos de la loi pour la confiance dans l’économie numérique et CC 27 juillet 2006, 2006-540, à propos de la loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information, rec. P. 88 et Dalloz, 2006, chron. P. 2157
[17] CE ass. 19 juin 1964, Société des pétroles Shell-Berre
[18] qui a conduit le Conseil constitutionnel à définir l’ordre juridique de l’Union européenne comme « ordre juridique intégré à l’ordre juridique interne » dans sa décision du 9 août 2012 relative au traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire.
[19] QPC, 14 juin 2013, n°2013-314, affaire JeremyF.
[20] CE, 8 juillet 2015, Mde Praingy et 14 septembre 2015, société Notrefamille.com
[21] Voir sur ce point Guide des institutions européennes à l’usage des citoyens, édité par l’Union européenne en 2014
[22] Cet arrêt a condamné la France pour violation de l’article 5-1 de la convention en vertu duquel toute personne ayant droit à la liberté et à la sûreté, nul ne peut être privé de sa liberté sauf dans les cas énumérés par cet article et selon les voies légales.
[23] 31 mars 1998, Reinhardt et Slimane KaÏd c/France ; 7 juin 2001 Kress c/France ; 12 avril 2006, grande chambre, Martinie c/France
[24] CEDH, 15 septembre 2009, Etienne c/France, qui relève que l’avis d’audience mentionnait la possibilité de cette demande
[25] La Cour reconnaît n’être appelée qu’ à un rôle « subsidiaire » par rapport aux systèmes nationaux de protection des droits de l’homme.Jurisprudence constante confirmée dans l’affaire Austin jugée en grande chambre le 15 mars 2012
[26] CE ass. n°358564, M.Vernes
[27] Cass. chambre sociale, 30 novembre 2005
[28] Pour une synthèse de l’application par la France des arrêts de la CEDH,voir notamment, sur le site conseil-etat.fr/actualites/discours, l’intervention d’Yves Robineau président de section au Conseil d’Etat à la Cour suprême d’Azerbaîdjan le 24 octobre 2014
[29] Cass. 3è civ., 6 mars 1996, D. 1997, jur. p. 167, note B de Lamy
[30] « Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’Etat, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi. Ils ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés ou approuvés »
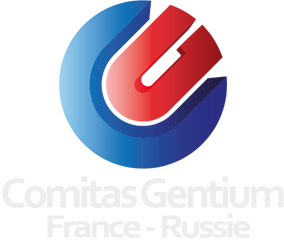



Recent Comments