La portée juridique du silence de l’administration en droit français
L’adage classique de la langue française « qui ne dit mot consent » trouvera t-il un jour de façon stable sa juste place en droit administratif ? Le présent article se propose de résumer l’évolution historique de la portée juridique conférée par le droit français au silence de l’administration afin de pouvoir apprécier la portée de l’article 1er de la loi du 12 novembre 2013 habilitant le gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens.
L’ambition politique de cet article 1er de la loi du 12 novembre 2013, habilitant le gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens[1] – dont le législateur a prévu l’entrée en vigueur pour partie un an et pour le surplus deux ans après la promulgation de la loi- a en effet été de poser la règle selon laquelle, sauf exceptions directement définies par la loi, ou encadrées par elle, avec renvoi au pouvoir règlementaire, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité administrative sur une demande vaut décision d’acceptation.
I- Dans une décision du 26 juin 1969, Protection des sites[2], le Conseil constitutionnel avait jugé que « d’après un principe général de notre droit », le silence observé par l’administration sur une demande de décision vaut rejet de cette demande. Il élevait ainsi au rang de principe général du droit une solution affirmée initialement par une loi du 7 juillet 1900, puis par l’article 1er d’ une loi du 7 juin 1956 et exprimée à l’époque de sa décision par le décret du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative.
La conséquence de cette décision du Conseil constitutionnel était, en vertu d’une jurisprudence bien établie, que la loi seule pouvait déroger à ce principe en instituant des cas, où le silence vaut acceptation de la demande. Cette conséquence était donc l’illégalité de nombreuses dispositions règlementaires ayant institué de tels cas, illégalité risquant d’être soulevée par voie d’exception à l’appui de recours pour excès de pouvoir formés contre des décisions individuelles faisant application de ces dispositions règlementaires et d’être ainsi source de désordres juridiques inutiles.
Cette situation était d’autant plus fâcheuse que, sous la Constitution de 1958, la procédure administrative, non contentieuse ou contentieuse, n’est pas, en elle même, au nombre des matières limitativement énumérées par l’article 34, dont la loi fixe les règles ou détermine les principes fondamentaux. En vertu de l’article 37, cette matière a donc un caractère réglementaire et, comme le précise cet article, les textes législatifs intervenus en cette matière avant l’entrée en vigueur de la Constitution peuvent être modifiés par décret en Conseil d’Etat. C’est pourquoi en 1965, un décret en Conseil d’Etat avait pu légalement abroger l’article 1er de la loi du 7 juin 1956, tout en reprenant la teneur de cet article dont la justification restait, comme le législateur de 1900 l’avait souhaité, de protéger les administrés en évitant que l’administration puisse par son silence faire obstacle à l’exercice du recours juridictionnel pour excès de pouvoir, lequel doit être dirigé contre une décision administrative.
Cependant, en vertu de l’idée que l’assimilation du silence de l’administration à une décision de rejet ne correspond pas à l’esprit des principes généraux du droit, qui est d’être favorable aux administrés, le Conseil d’Etat a, dès 1970[3], implicitement mais sans ambigüité possible, jugé que l’assimilation du silence observé par l’administration sur une demande de décision à une décision de rejet de cette demande ne procède que d’une «règle générale non écrite», à laquelle il est donc légalement possible d’apporter des exceptions par voie règlementaire.
Si cette règle générale réaffirmée par le décret du 11 janvier 1965 était que la décision implicite de rejet résultait du silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur la demande, des textes particuliers avaient prévu un délai plus court. Notamment un décret du 28 avril 1988 avait prévu que le silence gardé pendant un mois par l’autorité compétente sur une demande de communication de documents valait décision implicite de refus de communication.
Par ailleurs, la jurisprudence du Conseil d’Etat, puis un décret du 28 novembre 1983 sur les relations de l’administration avec les usagers avaient institué, dans certaines limites, une obligation de transmission de la demande à l’autorité compétente lorsque la demande avait été adressée à une autorité incompétente, cette transmission étant réputée faite dès le dépôt de la demande.
Enfin le délai, au terme duquel une décision implicite de rejet était réputée acquise, n’était pas susceptible d’interruption ou de suspension par lettres d’attente ou demandes de renseignement ou justification envoyées par l’administration. Autrement dit, le silence de quatre mois (ou d’une autre durée prévue par un texte particulier) devait être entendu comme absence de décision explicite pendant ce délai.
II-On l’a déjà dit, la règle générale selon laquelle le silence vaut rejet avait, à compter des années 1960, fait l’objet d’un nombre croissant de dérogations édictées par la loi ou le règlement, en particulier dans trois domaines importants : l’aménagement et l’utilisation des sols, notamment les permis tacites de construire et de démolir, le contrôle de l’emploi avec les autorisations tacites de licenciement et le droit hospitalier avec les autorisations tacites d’ouverture ou l’extension d’établissements sanitaires privés.
Le délai dont l’expiration provoquait la formation d’une décision implicite d’acceptation n’avait pas été déterminé de façon générale et, selon les domaines, variait de sept jours à plusieurs mois. Ce délai ne courait qu’à compter de la date à laquelle la demande était effectivement parvenue à l’autorité compétente et à condition qu’elle fût appuyée sur un dossier complet, c’est-à-dire comprenant les pièces exigées par les lois et règlements pour sa justification.
Par ailleurs, le délai de quatre mois nécessaire pour que le citoyen puisse se prévaloir d’une décision implicite de rejet lui permettant d’en contester la légalité devant le juge administratif fixé en 1900 par le législateur lui a paru un siècle plus tard excessif.
La loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations a donc d’abord, dans son article 21, prévu la réduction de ce délai à deux mois, en réservant la possibilité pour des décrets en Conseil d’Etat de prévoir un délai différent «lorsque la complexité ou l’urgence de la procédure le justifie».
Le législateur a ensuite entendu, dans les articles 22 et 23, à la fois déterminer le champ d’application possible et clarifier le régime juridique de décisions implicites d’acceptation:
- D’une part, ce n’est que dans les cas prévus par décret en Conseil d’Etat que le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande pendant deux mois, sauf délai différent prévu par ce décret si la complexité ou l’urgence de la procédure le justifie, vaut décision d’acceptation.
- D’autre part, le champ ouvert aux décrets en Conseil d’Etat est circonscrit: ils ne peuvent instituer un régime de décision implicite d’acceptation «lorsque les engagements internationaux de la France, l’ordre public, la protection des libertés ou la sauvegarde des autres principes de valeur constitutionnelle s’y opposent. De même, sauf dans le domaine de la sécurité sociale, ils ne peuvent instituer aucun régime d’acceptation implicite d’une demande présentant un caractère financier».
S’agissant du régime juridique de la décision implicite d’acceptation, la loi prévoit que cette décision peut, à la demande de l’interessé, faire l’objet d’une attestation et que, «si nécessaire», le décret doit définir les mesures destinées à assurer l’information des tiers.
Enfin la loi précise que la décision implicite d’acceptation ne peut être retirée par l’administration que pour illégalité et celà pendant le délai de recours contentieux de deux mois qui court, soit à compter des mesures d’information des tiers lorsqu’elles ont été mises en œuvre, soit à compter de la décision lorsque tel n’a pas été le cas, soit pendant la durée de l’instance au cas où un recours contentieux a été formé.
III- le législateur est à nouveau intervenu sur la question de la portée du silence de l’administration avec l’article 1er de la loi 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens.
L’économie de cet article, qui modifie les articles 20,21 et 22 de la loi précitée du 12 avril 2000 est que «le silence gardé pendant deux mois par l’autorité administrative sur une demande vaut décision d’acceptation», avec la précision que «La liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d’acceptation est publiée sur un site internet relevant du Premier ministre. Elle mentionne l’autorité à laquelle doit être adressée la demande,ainsi que le délai au terme duquel l’acceptation est acquise».
Toutefois, par dérogation à ce principe, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans trois hypothèses.
La première hypothèse est celle de quatre exceptions définies par la loi elle même, à savoir :
- les demandes ne tendant pas à l’adoption d’une décision présentant le caractère d’une décision individuelle ;
- les demandes ne s’inscrivant pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou règlementaire ou présentant le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif;
- les demandes présentant un caractère financier «sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret»;
- les demandes concernant les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
La deuxième hypothèse est celle des «cas, précisés par décret en Conseil d’Etat, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l’ordre public».
La troisième hypothèse résulte de l’habilitation donnée au pouvoir règlementaire, par décret en Conseil d’Etat et en conseil des ministres, d’écarter, pour certaines décisions, l’application du principe, selon lequel le silence gardé pendant deux mois par l’autorité administrative sur une demande vaut décision d’acceptation «eu égard à l’objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration».
Par ailleurs, est maintenue la règle déjà posée par la loi de 2000 selon laquelle, «lorsque l’urgence ou la complexité de la procédure le justifie», un décret en Conseil d’Etat peut fixer un délai différent que celui de deux mois de droit commun, tant pour les décisions implicites de refus, que pour les décisions implicites d’acceptation ; de même que la règle selon laquelle, la décision implicite d’acceptation fait l’objet, à la demande de l’interessé, d’une attestation délivrée par l’autorité administrative
Enfin, l’article 1er de la loi de 2013 s’efforce de préciser les dispositions de la loi de 2000 sur deux points importants.
Le premier concerne les conditions d’intervention d’une décision implicite d’acceptation. La loi de 2000 disposait déjà que le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite d’acceptation ne court qu’à compter de la date de réception de la demande par l’autorité compétente, laquelle doit en délivrer un accusé de réception. La loi de 2013 ajoute «Si cette autorité informe l’auteur de la demande qu’il n’a pas fourni l’ensemble des informations ou pièces exigées par les textes législatifs ou règlementaires en vigueur, le délai ne court qu’à compter de la réception de ces informations ou pièces».
Le second concerne l’organisation de la publicité d’une décision implicite d’acceptation lorsque le régime d’autorisation administrative en cause a prévu que la décision expresse, prise sur la demande d’autorisation, doit faire l’objet d’une mesure de publicité, parce qu’elle est susceptible de porter atteinte aux droits ou intérêts de tiers, ce qui est le cas, par exemple, en matière de permis de construire. La solution retenue par la loi est que «la demande est publiée par les soins de l’administration, le cas échéant par voie électronique, avec l’indication de la date à laquelle elle sera réputée acceptée si aucune décision expresse n’est intervenue». La loi ajoute que les conditions d’application de cette disposition sont précisées par décret en Conseil d’Etat.
La date d’entrée en vigueur de l’ensemble des modifications ci-dessus analysées, apportées aux articles 20, 21 et 22 de la loi du 12 avril 2000 par l’article 1er de la loi du 12 novembre 2013, a été réglée par ce même article de la façon suivante.
Un an après la promulgation de la loi, soit à compter du 12 novembre 2014, ses dispositions sont applicables pour les actes relevant de la compétence des administrations de l’Etat ou des établissements publics de l’Etat, et deux ans après cette promulgation, soit à compter du 12 novembre 2015, pour les actes relevant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, ainsi que pour ceux des organismes de sécurité sociale et des autres organismes chargés de la gestion d’un service public administratif.
A cette fin, le Gouvernement est autorisé, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi, à modifier par ordonnance les dispositions législatives prévoyant qu’en l’absence de réponse de l’administration dans un délai qu’elles déterminent, la demande est implicitement rejetée, un projet de loi de ratification devant être déposé devant le Parlement dans le délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
IV- Quelle appréciation de la portée donnée au silence de l’administration par cet article 1er de la loi du 12 novembre 2013 ? Celle proposée ci-après combine cinq considérations.
En premier lieu, il n’est guère possible dès à présent de déterminer si, sur le moyen et le long terme, cet article se révèlera avoir été un tournant décisif de «simplification» des relations entre les citoyens et les diverses autorités administratives, davantage que quatre autres articles de cette loi qui, avec le même objectif politique, habilitent le gouvernement à procéder par ordonnances, pour prendre des mesures, notamment en matière d’échanges avec l’administration par courrier électronique et de codification de textes.
En deuxième lieu, à y regarder de près, la détermination de la place faite à la décision tacite d’acceptation par le législateur de 2013 est, sur un plan strictement juridique, plus prudente que celle faite par le législateur de 2000. En effet, le texte de 2013 a mis fin au renvoi général de principe au décret au Conseil d’Etat, fût-il encadré par la loi, pour déterminer cette place. Puisqu’il exclut directement toute possibilité de décision tacite d’acceptation dans les cas analysés plus haut, avant de laisser à des décrets en Conseil d’Etat la possibilité de prévoir d’autres cas d’exclusion dans des hypothèses déterminées et, même au delà, à des décrets en Conseil d’Etat et en conseil des ministres la possibilité de prévoir d’autres exclusions «eu égard à l’objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration». Cette prudence est sans doute le fruit du mûrissement de la réflexion juridique à partir de la rédaction de la loi de 2000 sur ce point.
En troisième lieu, il reste vrai qu’au-delà de l’effet d’annonce politique permis par la première phrase de l’article 21 modifié de la loi de 2000 «le silence gardé pendant deux mois par l’autorité administrative sur une demande vaut décision d’acceptation», l’ensemble de l’article 1er de la loi du 12 novembre 2013 constitue une petite révolution sur le plan opérationnel du fonctionnement des pouvoirs publics.
Le pouvoir exécutif n’est plus, comme sous l’empire de la loi de 2000, maître du rythme avec lequel il entend, secteur par secteur de l’administration et régime par régime d’autorisation administrative, passer d’un système de décision tacite de rejet à un système de décision tacite d’acceptation. Il est contraint par les deux dates d’entrée en vigueur de l’article 1er , fixées par le législateur (avant le 12 novembre 2014 s’agissant des actes relevant de la compétence des administrations de l’Etat ou des établissements publics de l’Etat et avant le 12 novembre 2015 s’agissant des actes pris par les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que ceux des organismes de sécurité sociale et des autres organismes chargés de la gestion d’un service public administratif) d’avoir publié les décrets déterminant, dans les conditions prévues par la loi, les cas, non fixés par la loi elle-même où, par dérogation à la régle générale nouvelle posée par la loi, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet.
Un vaste chantier a donc été ouvert dans l’ensemble des ministères pour inventorier les procédures susceptibles ou non de faire l’objet du principe silence vaut acceptation. L’étude que, par lettre du 13 août 2013 le Premier ministre avait demandé au Conseil d’Etat sur l’application de ce principe et qui a été adoptée par l’assemblée générale plénière du Conseil d’Etat le 30 janvier 2014, a eu pour but de guider les services de l’Etat et des collectivités territoriales dans le travail d’identification des exceptions à la règle, en explicitant aussi précisément que possible les critères permettant de les définir et en s’efforçant de distinguer des catégories homogènes de décisions, «en vue de donner sa pleine portée à une réforme destinée à accélérer les délais de réponse des administrations pour simplifier les démarches administratives des citoyens et des entreprises».
Selon une déclaration du secrétaire d’Etat à la réforme de l’Etat en juillet 2014[4], en quelques mois, 3000 démarches administratives ont été passées en revue et 1200 auraient été identifiées comme pouvant bénéficier de la règle silence pendant deux mois vaut acceptation de la demande. Quoiqu’il en soit en définitive, la rédaction des décrets en Conseil d’Etat déterminant les exceptions au nouveau principe, qui seraient au nombre d’une quarantaine pour la première phase d’entrée en vigueur de la loi, a impliqué une mobilisation particulière des administrations et des formations administratives du Conseil d’Etat, pour que ces décrets puissent effectivement être publiés au Journal officiel avant l’entrée en vigueur de la loi du 12 novembre 2013.
La publication de l’ensemble de ces décrets, respectivement avant le 12 novembre 2014 ou avant le 12 novembre 2015 selon les actes en cause, répond à une double exigence de lisibilité et de sécurité juridique, tant pour les administrations elles-mêmes, que pour les usagers.
Elle est en outre, en pratique, le préalable indispensable à l’exécution de l’obligation, posée par la loi, de la publication sur un site internet relevant du Premier Ministre de la liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d’acceptation, cette liste devant mentionner l’autorité à laquelle doit être adressée la demande ainsi que le délai au terme duquel l’acceptation est acquise[5].
En quatrième lieu, le processus engagé n’exclut pas, et ne pouvait sans doute pas exclure a priori, toute incertitude juridique. Notamment, quid du statut de la liste publiée sur internet des procédures pour lesquelles le silence vaut acceptation ? Est-elle seulement un outil d’information du public ou serait-elle, le cas échéant, juridiquement opposable soit aux usagers, soit à l’administration ? Ce processus n’exclut pas non plus tout risque de contentieux délicats dans l’hypothèse où une procédure, qui aurait pu, selon l’administration, légalement faire l’objet d’un décret de dérogation dans un décret en Conseil d’Etat aurait été «oubliée» avant l’entrée en vigueur de la loi.
En cinquième lieu enfin, la loi de 2013 confirme que la question de la portée juridique du silence de l’administration demande en fait, une ingénierie juridique et pratique complexe. L’expérience historique a, en effet, montré que, quelle que soit la règle retenue, silence valant rejet ou silence valant acceptation, on ne pouvait raisonnablement dans un souci de bonne administration faire l’économie d’exceptions à y apporter.
Cependant, au-delà des problèmes provisoires divers générés par le changement de règle, la vraie question sera de savoir si le fait d’avoir transposé l’adage qui ne dit mot consent, par la loi, en matière administrative, sinon à la lettre du moins en esprit et en orientation, va effectivement contribuer à redonner aux citoyens confiance dans la pertinence et l’efficacité de leur administration publique et, à cette dernière, confiance en ellemême.
Bref, un dossier utile à suivre dans une optique comparatiste…
[1] Loi n°2013-1005 publiée au JORF n°0263 du 13 novembre 2013,p. 18407
[2] Recueil des décisions du Conseil constitutionnel, p.27, Actualité juridique 1969, p. 563
[3] CE Ass.27 février 1970, commune de Bozas, Recueil des décisions du Conseil d’Etat, p.139, Actualité juridique ,1970, p. 225
[4] rapportée dans un article de Xavier Sidaner Une règle du silence qui risque de faire du bruit publié le 14 octobre 2014 sur le site acteurspublics.com
[5] aussi,sur consultation du site service-public.fr dépendant du Premier ministre sur le point de savoir quand cette liste serait publiée,un responsable de ce site répondait le 16 octobre 2014 que « cette liste sera diffusée sur le site dès qu’elle nous sera transmise (a priori début novembre) »
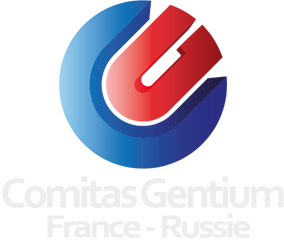



Recent Comments