Le juge administratif français et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales: du droit international au droit interne?
La convention européenne des droits de l’homme est, sans aucun doute, l’une des normes dont un juge administratif français est, aujourd’hui, le plus familier, même si elle n’est à l’évidence pas le seul texte qu’il applique en tant que juge national. Comment en est-on arrivé à ce que cette norme d’origine internationale, soit aujourd’hui à ce point intégrée à l’ordre juridique interne français ? Quelles sont les modifications que cette appropriation de la convention européenne des droits de l’homme par le juge administratif français a apportées au travail quotidien de celui-ci ? Qu’est-ce que cette situation a changé, de manière plus générale, pour la mission qu’exerce ce juge ?
La convention européenne des droits de l’homme est, sans aucun doute, l’une des normes dont un juge administratif français est, aujourd’hui, le plus familier. Elle n’est à l’évidence pas le seul texte qu’il applique. En tant que juge national, ce juge est d’abord, et avant tout, en charge de l’application et de l’interprétation des normes qui structurent son ordre juridique interne : la Constitution, la loi, le règlement et la jurisprudence des cours supérieures françaises. La Convention européenne des droits de l’homme n’en est pas moins, de manière évidente, une norme qui va traverser tout l’office de ce juge et qui, à l’instar des autres normes d’origine interne, fait aujourd’hui pleinement partie de son environnement.
Il y a de cela vingt ans, voire même encore dix ans ou même un peu moins, la seule pensée qu’il puisse en être ainsi aurait pu être regardée comme iconoclaste, voire à d’aucuns dangereuse. Et de fait, il n’est pas nécessairement évident pour un juge interne, quel qu’il soit, qui tire son existence et sa légitimité, même indirectement, de la Constitution qui le régit -c’est-à-dire de l’expression d’un peuple souverain-, d’envisager qu’une norme internationale puisse déterminer de manière aussi forte l’exercice de ses attributions et les contours de sa mission que le fait aujourd’hui la convention européenne des droits de l’homme.
Cela, est d’autant plus complexe pour un juge de l’administration et, en particulier, pour le juge administratif français compte tenu de son identité et de ses spécificités. La juridiction administrative est, en France, l’un des deux ordres de juridictions qui structure le paysage institutionnel de la justice en France. D’un côté, le juge judiciaire avec ses tribunaux, ses cours d’appel et sa Cour de cassation. Cet ordre de juridiction juge des affaires en matière civile et pénale. De l’autre côté, la juridiction administrative, également avec ses tribunaux de première instance, les tribunaux administratifs, ses cours administratives d’appel et le Conseil d’Etat, qui est le juge de suprême de l’ordre administratif et exerce également une fonction de conseil juridique indépendant du Gouvernement et du Parlement.
La mission du juge administratif, comme son nom l’indique, est de juger l’administration. Il le fait en tranchant des litiges portés devant lui par des personnes, physiques ou morales : particuliers, associations, entreprises, mais aussi des personnes publiques. Les juridictions administratives peuvent ainsi annuler un acte pris par une autorité publique ou condamner cette autorité à payer une somme d’argent. Elles traitent, parmi beaucoup d’autres exemples, de contentieux en matière d’urbanisme, d’impôts et de taxes, de responsabilité des hôpitaux publics, de marchés publics, de droit au logement, de permis de conduire, de fonction publique ou encore de contentieux relatifs à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des ressortissants étrangers…
Les juridictions administratives font application, en France, d’un droit particulier, distinct du droit qui est appliqué aux relations entre les personnes privées : le droit public. Ce droit, par son essence même, est lié à la fonction de contrôler de l’Etat, à la puissance publique. Il est donc éminemment rattaché à l’idée de souveraineté et, de ce fait, à l’origine du moins, ne s’accommode pas nécessairement aisément de l’irruption, dans le système qu’il représente, de droits venus de l’extérieur, comme celui de la convention européenne des droits de l’homme.
Pourtant, aujourd’hui, cette convention est un texte de référence, une norme qui accompagne un juge administratif, du matin au soir, dans l’exercice de sa mission. Lorsqu’il arrive dans sa juridiction, le matin, ce juge, s’il exerce les fonctions -les plus courantes- de rapporteur, prélève dans son stock plusieurs dossiers qu’il va traiter– la procédure est essentiellement écrite -. Avant d’examiner et d’analyser chaque dossier afin de proposer une première solution au litige, ce juge se pose systématiquement la question de son impartialité pour juger de ce litige : a-t-il un intérêt quelconque à l’affaire et, plus largement, existe-t-il des risques pour que, compte tenu de ses diverses appartenances ou de ses fonctions antérieures, surgisse un doute objectif sur sa capacité à juger ce litige de manière totalement indépendante et impartiale ? Si, bien évidemment l’indépendance et l’impartialité ont toujours été des principes essentiels à la fonction du juge administratif – comme de tout juge d’ailleurs-, le fait qu’un magistrat administratif français se pose aujourd’hui systématiquement cette question et, surtout, le fait qu’il se la pose en envisageant ne serait-ce que la possibilité d’un doute raisonnable sur son impartialité, est en grande partie le fruit de l’appropriation, par ce juge, des exigences du droit au procès équitable tel que celui-ci résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.
En analysant chacune de ces affaires, chacun de ces dossiers, ensuite, ce juge va être conduit à répondre à des arguments –l’on dit des « moyens »- invoqués par les parties. Parmi ceux-ci, l’on en trouvera bien évidemment qui sont tirés de la méconnaissance du droit interne –loi, jurisprudence, règlement, plus rarement la Constitution-. L’on trouvera aussi dans les écritures des parties, de manière parfaitement courante aujourd’hui, des moyens tirés de la violation de la convention européenne des droits de l’homme –une pure estimation pourrait être que de tels moyens sont invoqués dans au moins 60 % des litiges-. Dans le contentieux du séjour et de l’éloignement des ressortissants étrangers, par exemple, ce sont les articles 3 et 8 de la Convention qui sont le plus régulièrement invoqués. Le premier, qui prohibe les tortures et les traitements inhumains et dégradants, car il fait obstacle à ce que l’administration puisse éloigner un ressortissant étranger vers un pays où il risque de subir de tels agissements. Le second, car il s’oppose à ce que l’on puisse éloigner un ressortissant étranger qui dispose en France d’attaches personnes et familiales très intenses. L’on retrouvera fréquemment ces mêmes articles invoqués, par exemple, dans le contentieux des mesures pénitentiaires, lorsque les détenus contestent devant le juge la légalité de mesures prises à leur encontre telles qu’une mise à l’isolement, un transfèrement, des décisions de fouille intégrale…-. En ce qui concerne le contentieux des sanctions en matière fiscale, l’article 6 de la convention, qui protège le droit au procès équitable, est également invoqué de manière habituelle, comme par exemple l’article premier du premier protocole additionnel à la convention, qui protège le droit de chacun au respect de ses biens. L’on peut aussi évoquer une affaire pittoresque, bien que résultant de faits posant de réelles questions de sécurité, dans laquelle le droit à la vie protégé par l’article 2 de la convention a conduit le Conseil d’Etat, statuant selon une procédure d’urgence –le référé- à imposer à l’administration des mesures particulières de prévention contre les accidents liés aux requins sur l’île de la Réunion. Il s’agit d’une décision du Conseil d’Etat du 13 août 2013 qui atteste s’il le fallait que la convention est une norme omniprésente dans l’office du juge administratif, y compris lorsque celui-ci statue selon des procédures d’urgence.
Lorsque ce juge, ensuite, analyse chacun des dossiers qui lui sont confiés dans le but de proposer une première solution au litige, il examine les moyens des parties tirés de la violation de la convention européenne des droits de l’homme de la même manière que les moyens qui sont tirés de la violation du droit interne : il va rechercher le texte de l’article de la convention qui est invoqué par les parties, puis la jurisprudence des cours supérieures sur ce texte, celle du Conseil d’Etat, mais aussi celle de la Cour européenne des droits de l’homme, quel que soit l’Etat à l’encontre duquel la Cour a rendu son arrêt. Puis il détermine la réponse qu’il va donner à ce moyen (ya-t-il eu violation ou non de la Convention ?) en comparant les faits du litige qui lui est soumis avec les solutions rendues à l’occasion de ces précédents jurisprudentiels.
Lorsque ce juge siège en audience publique, les formations de trois juges auxquelles il participe – il s’agit de la configuration la plus fréquente-, entendent d’abord, pour chaque affaire appelée à l’audience, un autre juge, qui s’exprime en public et donne, en toute indépendance, son opinion motivée sur la solution qu’il considère devoir donner au litige. Ce juge s’appelle aujourd’hui le « rapporteur public ». La formation de jugement écoute ensuite les observations orales de chacune des parties qui sont présentes, avant de se retirer pour délibérer de la solution à donner au litige. Cette dernière s’appuie ainsi, à la fois, sur le dossier, sur le travail d’analyse du juge-rapporteur, sur l’opinion du rapporteur public et sur les observations orales des parties. Si ce juge qui parle – le rapporteur public-, s’exprime aujourd’hui avant les parties, autrement dit, si les parties peuvent répondre à ce juge, et si ce rapporteur public a perdu le nom qu’il portait autrefois –celui de « commissaire du gouvernement », qui n’exprimait en rien la réalité de ses fonctions-, c’est en grande partie, bien qu’indirectement, sous l’influence de la convention européenne des droits de l’homme et de la jurisprudence de la Cour.
La convention n’est pas, encore une fois, la seule norme qu’un juge administratif français croise en exerçant sa mission pendant une journée. Elle n’est pas, non plus, loin de là, la seule norme qu’il va appliquer ou qui va guider son office. Mais ces exemples tirés de l’activité quotidienne d’un tel juge attestent avec évidence que la convention européenne des droits de l’homme est aujourd’hui parfaitement intégrée dans son office, à l’instar, justement, de toutes ces autres normes d’origine interne. Et de fait, en tant que juge national, un juge administratif français est bien évidemment le juge, l’interprète, le gardien de son propre système juridique, mais il est aussi, dans le même temps, le juge de droit commun de l’application de la convention européenne des droits de l’homme.
I.- Comment en est-on arrivé à ce que cette norme d’origine internationale, soit aujourd’hui à ce point intégrée à l’ordre juridique interne français ?
II.- Quelles sont les modifications que cette appropriation de la convention européenne des droits de l’homme par le juge administratif français a apportées au travail quotidien de celui-ci ?
III.- Qu’est-ce que cette situation a changé, de manière plus générale, pour la mission qu’exerce ce juge ?
I.- Comment en est-on arrivé là ?
En dépit d’un cadre juridique favorable, l’appropriation de la Convention européenne des droits de l’homme –et de la jurisprudence de la Cour- par le juge administratif français a été un processus long. Celui-ci paraît néanmoins aujourd’hui pleinement achevé.
A.- Le cadre juridique français a toujours été, a priori, particulièrement favorable à la pleine intégration de la convention européenne des droits de l’homme dans l’office des juges internes et, donc, en particulier, dans celui du juge administratif.
Cela tient au fait que la France est, sur le plan des relations entre le droit interne et le droit international, un Etat de tradition dite « moniste ». Cette caractéristique découle directement du texte même de la Constitution ou, plus précisément, du Préambule de la précédente Constitution française, celle du 27 octobre 1946, qui dispose que la République française, « fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international ». Le Préambule de la Constitution française actuellement en vigueur, celle du 4 octobre 1958, renvoie à ce texte de la précédente constitution. Il en résulte que les normes d’origine internationale, pourvu qu’elles soient suffisamment précises et aient entendu conférer des droits aux personnes, autrement dit, pourvu qu’elles soient d’applicabilité directe (self executing) comme l’est la convention européenne des droits de l’homme, s’insèrent directement dans l’ordre juridique français sans qu’il soit nécessaire de les transposer par une norme de droit interne.
Plus encore, la place à laquelle s’insèrent les traités internationaux dans la hiérarchie des normes interne se présente aussi, a priori, comme favorable à une pleine intégration et à une pleine appropriation de la convention européenne des droits de l’homme par les juges internes. L’article 55 de la Constitution française du 4 octobre 1958 prévoit en effet que les traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois. Autrement dit –et tel est pleinement le cas aujourd’hui-, toute personne dont les droits garantis par la convention auraient été méconnus peut obtenir satisfaction devant un juge interne français en invoquant directement ces droits et, ce, alors même que la loi interne serait en sens contraire. Tel est le cas aujourd’hui, par exemple, dans le domaine du droit au séjour des étrangers. La loi française (le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) prévoit en effet de manière limitative les hypothèses dans lesquelles un ressortissant étranger peut obtenir un titre de séjour en France. Néanmoins, alors même qu’un étranger n’entrerait pas dans les hypothèses prévues par ces textes internes, le juge administratif, saisi d’un contentieux portant sur la légalité d’un refus de titre de séjour, pourra être conduit à ordonner à l’administration la délivrance d’un tel titre, si le requérant établit que son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention a été méconnu par la décision de refus des autorités administratives. Ce pouvoir découle directement du fait que, dans l’ordre juridique interne français, la convention européenne des droits de l’homme prévaut sur la loi.
B.- En dépit de ce cadre juridique –constitutionnel- favorable, la pleine intégration de la convention dans l’office du juge administratif français a été un processus long, qui n’a trouvé son plein aboutissement que récemment. Cela tient sans doute en grande partie aux craintes qui ont pu surgir –parfaitement compréhensibles du point de vue du système juridique d’un Etat souverain- face à la montée en puissance de ce droit étranger – voire étrange- souvent regardé comme vecteur de bouleversements pour les traditions juridique nationales.
L’on peut sans doute distinguer cinq étapes dans l’histoire des relations entre le droit public français et la convention européenne des droits de l’homme, qui ont progressivement conduit à la pleine acceptation de celle-ci. La première, que l’on pourrait appeler celle de l’indifférence paradoxale n’est pas propre au juge administratif. Elle résulte du fait que, jusqu’en 1974, la France n’était pas partie à la convention ou, plus exactement, ne l’avait pas ratifiée. Cela, alors même qu’elle avait été à l’initiative de la rédaction de cette convention et que le premier des présidents de la Cour avait été un français : René Cassin, qui avait été vice-président du Conseil d’Etat. La deuxième étape, de 1974 à 1989 et même, plus particulièrement, de 1981 –année au cours de laquelle le droit de recours individuel a été ouvert en France- à 1989, est celle de l’acculturation progressive. Le juge administratif français commence progressivement à appliquer la convention, mais en s’appliquant à ne pas faire de celle-ci un instrument de modification de sa propre jurisprudence, ni de ses traditions. Cette attitude a alors été exprimée de manière très nette par un « commissaire du gouvernement » qui deviendra plus tard président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, le président Labetoulle, qui, dans ses conclusions sur un arrêt Debout du 27 octobre 1978 invitait le Conseil d’Etat, d’une part, à « éviter toute solution qui serait radicalement incompatible avec la jurisprudence de la Cour » mais aussi, d’autre part, à « éviter aussi toute solution qui sur un point marquerait une rupture avec le droit national antérieur ». Fondamentalement, néanmoins, l’intégration de la convention est alors grevée par l’interprétation neutralisante que fait le Conseil d’Etat de l’article 55 de la Constitution, par laquelle il cantonne la supériorité des conventions internationales aux seules lois antérieures à l’introduction de ces dernières dans l’ordre juridique.
La pleine application de la convention débute avec la troisième étape, dont on peut fixer le point de départ en 1989, avec l’arrêt Nicolo, par lequel le Conseil d’Etat met fin, justement, à l’interprétation neutralisante de la Constitution qu’il avait adoptée jusque là. Cette étape conduit le juge administratif à faire application de la convention européenne des droits de l’homme, en pleine conformité avec l’interprétation qu’en donne la Cour, dans la plupart, si ce n’est dans tous les domaines du droit administratif : procédure juridictionnelle, droit et contentieux des ressortissants étrangers, urbanisme, contentieux de la responsabilité hospitalière, sanctions en matière fiscale… rares, voire inexistants, sont aujourd’hui les domaines qui échappent à l’application de la convention. La quatrième étape s’ouvre en 2001, avec l’arrêt Kress de la Cour européenne des droits de l’homme qui a condamné la présence du commissaire du gouvernement au délibéré des formations de jugement de la juridiction administrative française – même si cet arrêt ne représente que l’apogée symbolique d’une phase qui trouve ses racines antérieurement – avec l’arrêt Procola c/ Luxembourg notamment. Cette phase est celle du conflit procédural : la jurisprudence de la Cour sur le droit au procès équitable, particulièrement maximaliste, est alors perçue, en France, comme un instrument de déstabilisation des traditions juridiques nationales ; du procès administratif en particulier. Elle dure jusqu’en 2007, année qui ouvre la voie à une appropriation sereine de la convention : celle-ci fait désormais pleinement partie du paysage juridique du juge administratif, qui, tout en assurant un niveau de garantie des droits fondamentaux équivalent à celui qui résulte la jurisprudence de la Court, sait désormais pleinement concilier les exigences de ce texte avec sa propre tradition juridique.
II.- Quelles sont les modifications que cette pleine appropriation de la convention européenne des droits de l’homme a apportées au travail quotidien du juge administratif français ?
A.- Le premier constat que l’on peut semble-t-il opérer, est que l’appropriation de la convention européenne des droits de l’homme par le juge administratif français n’a finalement eu qu’une incidence modérée, voire très faible sur le plan du travail juridictionnel et de la procédure contentieuse.
Après plusieurs années de tensions et de critiques particulièrement vives à l’endroit de la Cour européenne des droits de l’homme, après plusieurs années de craintes de déstabilisation de notre système juridique, ce constat peut paraître étrange. Et pourtant : finalement, appliquer pleinement la convention ne nous a pas beaucoup coûté. Tout ce qui fait la tradition de la juridiction administrative a été préservé : que ce soit le déroulement du procès administratif avec l’intervention de ce magistrat qui s’exprime en public –le rapporteur public-, le fait que le Conseil d’Etat est à la fois un organe de conseil du gouvernement et un organe juridictionnel, nos modalités de fonctionnement interne… tout cela n’a pas été affecté par la convention et a même finalement été regardé par la Cour européenne des droits de l’homme comme participant pleinement à la qualité de la justice que nous rendons.
Que l’on ne s’y trompe pas, néanmoins : s’il en est ainsi, c’est bien le fait d’une volonté consciente ; c’est parce que la juridiction administrative, à son plus haut niveau, a résolument pris le parti, non plus de résister de toutes ses forces aux évolutions induites par la convention, au risque de se briser, mais bien de s’approprier ce texte et de véritablement dialoguer avec la Cour européenne des droits de l’homme : nous avons alors, tel le roseau, consenti à des évolutions, qui n’étaient certes pas marginales, mais qui nous ont permis de conserver nos racines et de préserver l’essentiel. En outre, « conserver l’essentiel » ne signifie pas rester immobile : la justice administrative française a profondément évolué au cours des dernières années – et elle continue de le faire. La convention est l’un des facteurs de cette évolution, mais pas le seul. Mais elle a peut-être, plus que les autres révélé que l’une des forces de cette juridiction est de savoir s’adapter constamment à la société contemporaine, tout en préservant tous les aspects hérités de son passé qui font sa légitimité et son utilité pour la protection des droits fondamentaux et la défense de l’intérêt général.
B.- Qui plus est, le second constat que l’on peut faire est que les changements qui sont intervenus dans la procédure juridictionnelle et dans l’organisation de la juridiction administrative française, directement ou indirectement, sous l’effet de la convention européenne des droits de l’homme, peuvent être regardés comme ayant eu un caractère positif.
Il paraît peu utile, à tout le moins dans le contexte de cette conférence, de détailler ces changements, donc certains, telles l’attention portée à l’apparence d’impartialité, l’inversion du déroulé de l’audience ou la modification du nom du « commissaire du gouvernement » en « rapporteur public » ont d’ores et déjà été évoqués. Plus pertinente est peut-être l’expression de la dynamique qui, d’une manière ou d’une autre, me paraît avoir inspiré ces modifications. Ce qu’a en effet apporté la convention européenne des droits de l’homme et la jurisprudence de la Cour à l’organisation et au fonctionnement de la juridiction administrative française, je le crois, c’est d’avoir placé le justiciable, le particulier, la personne, plus encore qu’il ne l’était avant, au cœur de nos préoccupations.
Historiquement, la juridiction administrative française est née d’une fonction de contrôle de l’Etat et des administrations publiques. Pour le dire plus clairement, elle est née de l’administration, dont elle a pris son indépendance complète depuis près de 140 ans, (en 1872). Sa fonction est à l’origine essentiellement, et encore en grande partie aujourd’hui, de contrôler la légalité d’un acte administratif. Autrement dit, l’objet principal du procès administratif, au travers de ce que nous appelons le « recours pour excès de pouvoir », n’est pas constitué par les personnes que visent cet acte, mais bien par l’acte lui-même. Le fait même qu’existent des parties dans ce procès, autrement dit des personnes, des justiciables, est aujourd’hui pleinement reconnu, mais l’idée n’allait pas nécessairement de soi il y a de cela encore une soixantaine d’années.
Si la juridiction administrative avait depuis longtemps elle-même évolué dans le sens d’une prise en considération accrue de la présence et de l’intérêt des justiciables, la convention européenne des droits de l’homme ou même, plus particulièrement, la jurisprudence de la Cour européenne a largement contribué à accélérer ce processus, voire à le faire aboutir. L’arrêt Kress de la Cour précédemment évoqué, n’a pas marqué le début ni l’aboutissement de cette influence de la convention sur l’appréhension de la place des justiciables dans le procès administratif, mais il a été à cet égard particulièrement symbolique. Cet arrêt, par lequel la Cour a jugé que la présence de ce juge qui parle, alors appelé « commissaire du gouvernement », au délibéré des formations de jugement, violait le droit au procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la convention, a en effet été l’une des grandes figures, voire l’étape marquante de cette phase de « conflit procédural » évoquée précédemment. Mais ce qui fut aussi marquant –bien que peut-être moins relevé- dans cet arrêt, c’est aussi le fait que cette condamnation d’un aspect de la procédure contentieuse administrative française l’était au nom de l’incompréhension que pourrait manifester, devant la présence de ce « commissaire du gouvernement » au délibéré des formations de jugement, « un justiciable non rompu aux arcanes de la justice administrative ». L’expression se suffit à elle-même : ce qu’a apporté la Cour européenne des droits de l’homme à la juridiction administrative française, c’est aussi cette pleine confrontation, légitime dans un pays démocratique, à ce justiciable non spécialiste, à cette personne ordinaire, qui constitue, au-delà de l’acte administratif, l’objet véritable de notre mission. Tout cela, encore une fois, sans remettre en cause les fondements du procès administratif, mais en générant des évolutions qui ont contribué à faire de la justice que nous rendons une justice sans doute mieux compris, mieux acceptée… et, donc, socialement encore plus utile. Si nous ne le devons pas seulement à la convention européenne des droits de l’homme, celle-ci a indéniablement été un moteur puissant de cette évolution.
III.- Quelles sont les évolutions que la pleine appropriation de la convention européenne des droits de l’homme a apportées à la définition des missions de la justice administrative française ?
L’évolution des missions du juge administratif induites par l’appropriation de la convention européenne des droits de l’homme a été, à mon sens, particulièrement sensible. Et c’est d’ailleurs cela qui paraît important : cette appropriation, tout en les faisant évoluer, n’a pas bouleversé nos traditions, ni remis en cause la qualité de notre travail, mais elle a contribué à faire évoluer nos missions, sans doute en permettant de les rapprocher encore plus qu’avant, non seulement d’un idéal qui est celui de tout juge, mais aussi d’une composante essentielle de la démocratie. Je veux dire l’Etat de droit.
A.- La première des deux dynamiques d’évolution des missions du juge administratif français que l’on peut identifier, à mon sens, est l’approfondissement du contrôle que nous exerçons sur l’action de l’administration.
Dans de nombreuses hypothèses, le juge administratif n’exerçait encore, à la fin des années 1980, qu’un contrôle restreint sur la qualification juridique des faits opérée par l’administration. Ce contrôle ne conduisait à censurer, dans de nombreux domaines, que les erreurs les plus grossières – les « erreurs manifestes d’appréciation » ainsi que nous les appelons. Tel était le cas, notamment, dans de nombreux domaines de la police administrative – que l’on appelait encore parfois la « haute police » – comme les mesures prises en matière de séjour et d’éloignement des étrangers, mais pas uniquement. Or, à la faveur de l’appropriation progressive de la convention européenne des droits de l’homme, ces domaines dans lesquels le juge laissait à l’administration une grande marge de manœuvre, se sont réduits et, parallèlement, le contrôle de proportionnalité que connaissait déjà le juge administratif –il le pratiquait dans certaines domaines depuis 1933- s’est, à la fois étendu, et renforcé. Or, ce principe de proportionnalité, qui implique un contrôle étroit sur l’action de la puissance publique, celle-ci ne devant pas excéder les limites strictement nécessaires à l’accomplissement de ses missions, revêt une dimension centrale dans la protection des libertés et des droits fondamentaux et, partant, pour l’Etat de droit.
B.- La seconde dynamique d’évolution des missions du juge administratif sous l’effet de l’appropriation de la convention européenne des droits de l’homme est sans aucun doute, à côté de l’approfondissement du contrôle, l’extension du champ des activités de l’administration sur lesquelles nous exerçons un tel contrôle.
Il existait en effet encore, jusqu’il y a peu, des domaines relativement étendus de l’action de l’administration sur lesquels le juge n’exerçait aucun contrôle : il déclarait les requêtes présentées devant lui dans ces domaines comme irrecevables. Ces domaines relevaient soit de la catégorie dite des « actes de gouvernement », correspondant à des décisions que nous estimions relever du champ de la vie politique et non administrative, soit de la catégorie des mesures dite « d’ordre intérieur », correspondant à des situations particulières – les écoles, les prisons, l’armée par exemple- dans lesquelles le juge administratif estimait que l’autorité hiérarchique devait disposer d’une marge de manœuvre étendue. Avant le milieu des années 1995, pour prendre l’exemple du milieu carcéral, le contrôle du juge administratif n’entrait pas dans les prisons. Autrement dit, si les prisons n’étaient pas bien évidemment pas une zone de non droit, il existait néanmoins tout un pan de l’action de l’administration pénitentiaire –par exemple les mesures de mise à l’isolement, les sanctions disciplinaires, les transfèrements- qui ne faisaient l’objet d’aucun contrôle de la part d’un juge, alors même que ces mesures, a fortiori dans le cadre très particulier de ce milieu clos, sont susceptibles d’être attentatoires aux droits fondamentaux. Si, depuis, nous avons profondément fait évoluer notre jurisprudence dans ce domaine, en exerçant désormais sur ces mesures un véritable contrôle au regard des droits fondamentaux, sauf si nous estimons qu’elles n’ont pas pour effet de porter la moindre atteinte à de tels droits, et bien c’est essentiellement parce que nous nous sommes appropriés les exigences de la convention. Et c’est bien le terme « appropriation » qui est important : dans ce domaine comme dans les autres, nous suivons, bien évidemment, la jurisprudence de la Cour, mais nous allons aussi au-delà, en intégrant, non pas nécessairement telle ou telle décision, mais le sens de cette jurisprudence et en l’adaptant au contexte particulier et aux traditions particulières de contrôle qui sont les nôtres. Il n’y a donc pas, encore une fois, de bouleversement de notre ordre juridique, mais bien un approfondissement de notre mission fondamentale de juge, qui est la protection des droits fondamentaux et la conciliation la plus étroite possible du respect de ceux-ci, avec les exigences inhérents aux nécessités de l’action publique.
*
* *
Ce qui paraît le plus déterminant dans ce qu’a apporté la convention européenne des droits de l’homme au juge administratif français, c’est qu’elle a achevé et, sans doute, accéléré, une évolution qui était d’ores et déjà en cours, en plaçant la protection des droits fondamentaux et, plus généralement, des droits des personnes, au cœur de l’office de ce juge. Etre juge administratif, juger l’administration, c’est essayer constamment de trouver un équilibre entre, d’un côté, l’intérêt général que représente la puissance publique, qui doit agir pour le bien de tous et pas seulement d’une ou plusieurs personnes et, de l’autre côté, la protection des intérêts et des droits légitimes des personnes. Le juge administratif français s’est construit à partir de l’administration. Il a profondément évolué lorsqu’il a acquis sa pleine indépendance, à la fin du XIXème siècle et, plus encore, après la seconde Guerre mondiale, en devenant un juge des libertés publiques – c’est-à-dire des libertés protégées par l’Etat. Avec la convention européenne des droits de l’homme, il est devenu un juge des droits fondamentaux, un juge des droits de l’homme et il accomplit ainsi pleinement sa mission dans la société. Si, être juge, c’était un tableau, ce serait la Joconde, ou plus précisément le sourire de la Joconde, ce sourire énigmatique, secret, qui guide le regard du chaos vers la paix. Et dans ce tableau, pour un juge d’Europe, la convention européenne des droits de l’homme serait l’un des coups de pinceaux du maître. Celui qui, parmi tous les autres, rend si beau le sourire de Mona Lisa.
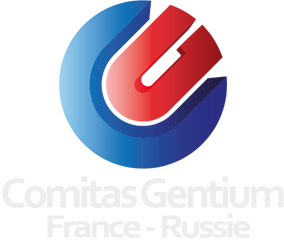



Recent Comments