Les grands mouvements du droit administratif français (florilège) 2016-2018
La difficulté de l’exercice provient du fait qu’il convient tout à la fois de souligner des évolutions communes à l’ensemble des thématiques abordées en droit administratif – qui sont donc transversales – mais également des évolutions qui caractérisent certaines branches seulement du droit administratif. Autrement dit, il s’agit de présenter dans un même mouvement les tendances générales et des tendances sectorielles.
Ceci explique que des choix aient été opérés, supposant une certaine dose d’arbitraire dans la détermination des réformes et des jurisprudences qui vont être étudiées comme étant représentatives des récents mouvement du droit administratif. Cinq thématiques seront successivement évoquées :
1° Le droit administratif français s’est saisi de nouveaux objets ;
2° Le droit administratif a promu la sécurité juridique ;
3° Le droit administratif a parachevé l’intégration de certains principes généraux issus du droit de l’Union européenne ;
4° Le droit administratif a tenté d’encadrer la lutte du Gouvernement contre le terrorisme ;
5° Le droit administratif a été confronté à la dématérialisation des rapports avec les administrés.
1° Le droit administratif s’est saisi de nouveaux objets
On peut, schématiquement, envisager plusieurs hypothèses dans lesquelles de nouveaux objets viennent à être régis par le droit administratif.
Tout d’abord, parce qu’ils viennent d’être institués et que le législateur ou le juge décident de leur appliquer les règles du droit administratif. Ainsi a-t-on créé de nouvelles catégories de contrats que l’on a décidé de qualifier de contrats administratifs. Ainsi a-t-on créé de nouveaux établissements que l’on a décidé de qualifier d’établissements publics administratifs.
Ensuite, parce que bien qu’existant depuis longtemps, certains objets juridiques ont été soustraits par le juge ou le législateur aux règles du droit privé et à la compétence du juge judiciaire. Ainsi, par le biais de plusieurs décisions conjuguées du Conseil d’Etat et du Tribunal des conflits, le juge administratif a vu sa compétence très largement augmenter du fait d’une nouvelle définition donnée à la notion de voie de fait et de la quasi destruction de la notion d’emprise irrégulière.
Enfin, parce que ces objets étaient jusqu’alors délaissés du champ du droit et que le législateur ou le juge ont décidé de leur attribuer un régime juridique et contentieux particulier.
Sur ce point, les années 2016-2018 ont justement été l’occasion pour le Conseil d’Etat de se saisir de ce que l’on appelle les actes de droit souple qui, auparavant, étaient assez rétifs à tout analyse juridique bien qu’ils soient couramment adoptés par les autorités de régulation, mais qui font dorénavant l’objet d’un statut contentieux qui se perfectionne petit à petit.
Déjà, en 2013, le Conseil d’Etat avait consacré son rapport annuel à la question du droit souple et l’avait défini comme désignant un ensemble des mesures présentant trois caractéristiques :
– ils ont pour objet de modifier ou d’orienter les comportements de leurs destinataires en suscitant, dans la mesure du possible, leur adhésion ;
– ils ne créent pas par eux-mêmes de droits ou d’obligations pour leurs destinataires ;
– ils présentent, par leur contenu et leur mode d’élaboration, un degré́ de formalisation et de structuration qui les apparente aux règles de droit.
Or, à moins de contractions extrêmes de la notion d’acte administratif unilatéral, il était très difficile de faire entrer les actes de droit souple dans les catégories classiques du droit administratif, notamment celle de décision administrative. Ceci engendrait une difficulté majeure pour les administrés et les justiciables : l’impossibilité de contester ces mesures devant le juge, alors que l’administration, qui use de plus en plus de ces modalités d’action, en tire de d’importantes conséquences.
Le 21 mars 2016, le Conseil d’Etat a rendu deux arrêts par lesquels il a entamé l’élaboration du régime contentieux des actes dits de droit souple adoptés par les autorités de régulation (CE, Ass., 21 mars 2016, , Sté Fairvesta et a. ; Sté Numericable ). Il a admis la recevabilité du recours pour excès de pouvoir à l’encontre de mesures de droit souple dans deux situations : d’abord, au regard de leurs effets notables, notamment économiques ; ensuite lorsqu’ils sont de nature à influer sur les comportements de leurs destinataires. En effet, selon la formule employée par le Conseil d’Etat, un recours pour excès de pouvoir est recevable à l’encontre d’une mesure de droit souple, alors même qu’elle ne peut être considérée comme une véritable décision administrative, lorsqu’ « elle est de nature à produire des effets notables, notamment de nature économique, ou a pour objet d’influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles ils s’adressent ». Le requérant pourra alors soulever tout moyen de légalité externe et interne en vue d’en obtenir l’annulation. Le juge administratif, de son côté, fera varier l’intensité de son contrôle en fonction des caractéristiques de la mesure contestée et du pouvoir d’appréciation dont dispose l’administration.
Par la suite, le Conseil d’Etat a fait application de cette jurisprudence à plusieurs reprises : dans un arrêt de Section du 31 juillet 2016 au sujet d’une simple communication adoptée par la Commission de régulation de l’énergie ; dans un arrêt du 10 novembre 2016 relatif à une délibération du CSA. Plus récemment encore, suivant un raisonnement comparable à celui qui vient d’être évoqué, le Conseil d’Etat a reconnu la recevabilité du recours pour excès de pouvoir à l’encontre des lignes directrices adoptées par les autorités de régulation. Celles-ci ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles les autorités de régulation entendent mettre en œuvre les prérogatives dont elles sont investies. Elles se rapprochent des lignes directrices adoptées par les chefs de service (ministres) à destination de leurs subordonnées, mais s’en distingue toutefois du fait qu’elles sont adressées directement aux opérateurs qui sont par ailleurs souvent appelés à participer à leur élaboration (comme dans le cas d’espèce : CE, 13 décembre 2017, Sté Bouygues Telecom).
2° Le droit administratif a promu la sécurité juridique
Il s’agit de l’une des tendances les plus caractéristiques du droit administratif contemporain, où l’on voit le juge tout à la fois inaugurer de nouveaux recours ou de nouvelles techniques de contrôle au profit des justiciables et, dans un sens qui semble totalement inversé, restreindre les conditions dans lesquelles les recours peuvent être introduits (conditions de recevabilité) et les moyens qui sont susceptibles d’être invoqué devant lui. Et ce, dans le but de préserver le principe de sécurité juridique au profit, il faut bien l’admettre, de l’administration qui s’est également vu reconnaître le droit de régulariser ses propres décisions irrégulières (CE, Sect., 1er juill. 2016, n° 363047 et n° 363134, Commune d’Emerainville).
En cela, le juge administratif est aidé par le législateur et le pouvoir réglementaire qui, eux aussi, oscillent entre l’ouverture de nouveaux recours au profit des justiciables (par exemple l’action en reconnaissance de droits et l’action de groupe qui ont été instituées par la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle du 18 novembre 2016) et la restriction de l’accès au juge. Par exemple, le Gouvernement a sensiblement renforcé les conditions d’accès au juge administratif lors de l’adoption d’un décret dit JADE du 2 novembre 2016.
Au profit des justiciables, on peut évoquer la jurisprudence admettant pour la première fois la recevabilité du recours pour excès de pouvoirs dirigé contre les rescrits, c’est à dire les actes par lesquels l’administration se prononce, à la demande d’un administré, sur la légalité d’une situation de fait particulière ou d’une opération projetée par un administré (CE, Sect., 2 déc. 2016, Ministre des Finances et Comptes publics c/ Sociét. Export Press ). On peut également citer l’arrêt par lequel le Conseil d’Etat a admis de manière générale la recevabilité du recours de plein contentieux exercé par un tiers à un contrat administratif souhaitant contester le refus de l’administration de résilier le contrat (CE, Sect., 30 juin 2017, n° 398445, Syndicat mixte de promotion de l’activité transmanche). Ce faisant, le Conseil d’Etat a poursuivi son œuvre d’unification du contentieux contractuel entre les mains du juge du plein contentieux.
On peut enfin évoquer un arrêt récent par lequel le Conseil d’Etat a admis que, dans certains cas exceptionnels, « la compatibilité de la loi avec les stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne fait pas obstacle à ce que, dans certaines circonstances particulières, l’application de dispositions législatives puisse constituer une ingérence disproportionnée dans les droits garantis par cette convention. Il appartient par conséquent au juge d’apprécier concrètement si, au regard des finalités des dispositions législatives en cause, l’atteinte aux droits et libertés protégés par la convention qui résulte de la mise en œuvre de dispositions, par elles-mêmes compatibles avec celle-ci, n’est pas excessive ». Ce faisant, tout en admettant que le juge du référé liberté puisse dorénavant examiner la conventionalité d’une loi, le Conseil d’Etat a procédé à une appréciation in concreto de l’application de la loi aux individus et s’est assuré que sa mise en œuvre n’entraînera pas de conséquences manifestement contraires aux exigences nées des engagements internationaux.
Au profit de la sécurité juridique, et donc au détriment des justiciables, on peut évoquer deux mouvements symptomatiques. Le premier s’illustre par le fait que, tout en ouvrant de nouveaux types de recours, le Conseil d’Etat les a soumis à des conditions de recevabilité ou d’opérance des moyens très strictes qui conduisent certains observateurs à estimer que la situation des justiciables n’a en réalité pas été améliorée, tant s’en faut ! Certains estiment même que le juge administratif a délaissé le principe de légalité administratif au profit de celui de sécurité juridique. Au-delà du contentieux contractuel qui illustre parfaitement cette tendance, on peut évoquer le contentieux du référé mesures utiles qui a vu le Conseil d’Etat, par une interprétation très stricte des dispositions du Code de justice administrative, rendre quasiment impossible son utilisation par les justiciables, alors que l’administration en a un usage très fréquent (CE, Sect., 5 févr. 2016, n° 393540 et n° 393541, Benabdellah).
Le second mouvement s’illustre par le fait que le Conseil d’Etat n’hésite pas à adopter de manière prétorienne de nouveaux principes de procédure tout en s’auto-attribuant un label de conventionalité au regard de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Deux arrêts récents permettent de le mettre en lumière :
Le premier est un arrêt Czabaj rendu en Assemblée le 13 juillet 2016 qui crée de toute pièce un délai raisonnable (généralement d’un an) à l’expiration duquel un justiciable n’est plus recevable à attaquer une décision administrative individuelle, alors même que le délai de recours contentieux n’avait pas commencé à courir à son égard en raison d’une irrégularité de forme (défaut de précision, dans la notification de la décision contestée, des voies et délais de recours).
Le second est un arrêt du 18 mai 2018 (2 affaires) par lesquels le Conseil d’Etat a jugé que, même si l’administration est tenue d’abroger un acte administratif réglementaire illégal, un requérant n’est plus en mesure de contester son illégalité ou le refus de l’abroger, s’il n’invoque qu’un vice de forme ou de procédure à l’occasion d’un recours dirigé contre une mesure individuelle d’application (CE, 18 mai 2018, Fédération des finances et affaires économiques de la CFDT).
3° Le droit administratif a parachevé l’intégration de certains principes généraux issus du droit de l’Union européenne
Il est possible d’évoquer ici deux grands mouvements du droit administratif français contemporain qui ont tous deux été provoqués par la volonté d’intégrer en droit français certains principes généraux promus par le droit de l’union européenne : l’un touche les contrats de la commande publique, l’autre touche les autorisations accordées aux entreprises qui souhaitent occuper le domaine public pour y exercer leurs activités.
Le premier mouvement est celui de l’unification du droit de la commande publique, autrement dit du droit applicable aux contrats de marchés publics et de concession. D’emblée, il faut préciser que ce mouvement n’est pas encore achevé. Le sera-t-il d’ailleurs jamais ? En tout état de cause, la prochaine étape de cette unification résultera de l’adoption d’un Code de la commande publique qui a fait l’objet d’une consultation organisée par le gouvernement et qui devrait être publié dans les semaines à venir.
Afin d’assurer la transposition en France des directives européennes de 2014 relatives aux marchés publics et contrats de concession, le gouvernement a été habilité par le Parlement (loi du 2 juillet 2003) à adopter des ordonnances visant à rendre le droit français compatible avec le droit européen.
Sur le fondement de cette habilitation, deux ordonnances ont donc été adoptées : l’une du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, l’autre du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession. Or, sans qu’ils soit nécessaire d’entrer dans le détail de ce qu’elles prévoient, on peut observer que ces ordonnances ont procédé à un travail de mise en ordre et d’unification du droit applicable aux contrats de la commande publique. Comment ? De deux manières principales :
D’abord en réunissant en un seul corpus normatif l’ensemble des dispositions qui étaient auparavant applicables aux marchés publics et contrats de concession. Pour des raisons propres aux définitions françaises, il existait en effet une pluralité de textes applicables dont le champ d’application divergeait : Code des marchés publics, Loi du 26 janvier 1993 dite Loi Sapin relative aux délégations de services publics, Ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés publics non soumis au Code des marchés publics ; Ordonnance du 17 juin 2004 relative aux contrats de partenariats, etc… Les ordonnances bientôt codifiées ont alors eu le mérite de regrouper l’ensemble des dispositions applicables ce qui, même si la notion a pu être contestée, a eu pour effet de donner une réelle consistance à la notion de commande publique.
Ensuite, les ordonnances ont procédé à une unification des qualifications juridiques des contrats de la commande publique. Ici encore, pour des raisons propres au dualisme français, les contrats auparavant soumis aux divers textes qui viennent d’être évoqués pouvaient tantôt être des contrats de droit public, tantôt des contrats de droit privé, y compris lorsqu’ils étaient conclus par des personnes publiques. Ceci impliquait qu’en cas de recours contentieux, il convenait de saisir soit le juge administratif soit le juge judiciaire. Dorénavant, il est prévu que les contrats de la commande publique conclus par des personnes publiques soumises aux ordonnances (pouvoirs adjudicateurs et autorités concédantes) sont des contrats administratifs, ce qui a pour effet d’unifier leur contentieux devant le juge administratif.
Les appréciations portées par la doctrine sur ce type de qualification législative sont variables : pour certains, il s’agit d’une heureuse simplification ; pour d’autres, au contraire, l’intervention du législateur ne fait que rendre plus complexe encore la définition du contrat administratif et lui enlève sa cohérence : ce qui revient in fine à remettre en cause l’idée et l’utilité d’une théorie générale des contrats administratifs.
Le second mouvement concerne les autorisations accordées par l’administration aux entreprises afin qu’elles puissent exercer leur activité marchande sur le domaine public. Le droit domanial français a toujours été réticent à soumettre ces autorisations à une quelconque obligation de publicité et de sélection préalable des candidats, du moins lorsque ces autorisations ne constituaient pas en même temps un contrat de marché public ou de concession. Et ce, alors même qu’il est admis qu’un titre d’occupation privative du domaine public constitue pour une entreprise un avantage concurrentiel indéniable. Le Conseil d’Etat avait pourtant considéré qu’aucun principe n’impose à l’administration l’obligation « d’organiser une procédure de publicité préalable à la délivrance d’une autorisation ou à la passation d’un contrat d’occupation d’une dépendance du domaine public, ayant dans l’un ou l’autre cas pour seul objet l’occupation d’une telle dépendance ; qu’il en va ainsi même lorsque l’occupant de la dépendance domaniale est un opérateur sur un marché concurrentiel » (CE, Section, 3 décembre 2010, Association Jean Bouin).
La Cour de justice de l’Union européenne n’a pas été de cet avis, qui a considéré que le principe de transparence impose aux autorités publiques de procéder à une publicité préalable et à l’organisation d’une procédure de sélection lorsqu’un opérateur sur un marché concurrentiel souhaite exercer son activité sur le domaine public. Aussi, le Gouvernement a à nouveau été habilité à modifier le Code général de la propriété des personnes publique, ce qu’il fit par une ordonnance du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques. Celle-ci prévoit que : « lorsqu’une autorisation permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, l’autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester ».
Il ne fait guère de doute qu’une telle disposition illustre le fait que le principe européen de transparence des procédures et peut être plus généralement les principes généraux de la commande publique, ont vocation à s’appliquer bien au-delà de la seule sphère des contrats de la commande publique.
4° Le droit administratif a tenté d’encadrer la lutte du Gouvernement contre le terrorisme et a tenté de défendre le principe de la laïcité
L’instauration de l’état d’urgence (Loi du 3 avril 1955 modifiée par la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015) à la suite des attentats terroristes ayant frappés la France à plusieurs reprises a constitué un véritable test pour notre état de droit et l’occasion de vérifier si, même dans les situations les plus graves, le juge administratif et le droit qu’il applique constituent des remparts contre l’arbitraire et des garants de nos libertés essentielles.
Tout particulièrement, le juge du référé liberté dont l’office l’autorise à faire cesser toute atteinte grave et manifestement illégale portée par l’administration aux libertés fondamentales a été sollicité à plusieurs reprises.
Ainsi, le Conseil d’Etat a admis (CE, Sect., 11 décembre. 2015, n° 395009, Domenjoud) que le juge des référés, malgré la situation d’urgence, est en mesure de poser une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel visant à contrôler la conformité de la loi aux droits et libertés garantis par la Constitution. Dans le même ordre d’idée, il est en mesure de contrôler la conformité de la loi à la CEDH.
Ensuite, le juge du référé liberté a été saisi de différentes mesures adoptées sur le fondement de l’état d’urgence : assignation à résidence, perquisitions administratives, etc.
Par exemple, il a jugé qu’une mesure d’assignation à résidence fait naître une présomption d’urgence, urgence qui est une condition de recevabilité du référé-liberté. En revanche, alors qu’il est censé exercer un contrôle de proportionnalité des mesures d’assignation à résidence, il a retenu une conception fort large des motifs justifiant de telles mesures.
De même, concernant les perquisitions administratives, (CE, Ass., avis, 6 juill. 2016, Napol et a.), le Conseil d’Etat, a estimé que ces mesures doivent être motivées et doivent faire l’objet d’un contrôle de proportionnalité de la part du juge administratif.
Enfin, le juge administratif a statué sur l’engagement de la responsabilité de l’Etat du fait de la mise en œuvre de l’état d’urgence. Au sujet des perquisitions administratives, le même avis affirme que la responsabilité de l’Etat peut être engagée pour faute simple, ce qui constitue une nouvelle exception à l’exigence d’une faute lourde en matière de police administrative. Sur ce fondement, le Conseil d’Etat admettra par la suite la responsabilité de l’Etat du fait de son impuissance à empêcher le départ de mineurs vers la Syrie (CE, 26 avr. 2017, n° 394651 , M. et Mme Aubry-Dumont ). Par ailleurs, le Conseil d’Etat admet que les tiers aux opérations de perquisition administrative peuvent, s’ils subissent un préjudice spécial et anormal, engager la responsabilité de l’Etat sans faute, sur le fondement du principe d’égalité devant les charges publiques.
On notera, de manière incidente, que le Conseil d’Etat a limité la possibilité pour les autorités de police administrative d’invoquer le contexte de l’état d’urgence et l’émoi provoqué par les attentats pour adopter des mesures visant, sous couvert de respect du principe de laïcité, à interdire sur les plages publiques le port de vêtements de baignade manifestant une adhésion à la religion musulmane (CE, 26 août 2016, n° 402742 et n° 402777, Ligue des droits de l’homme et a.).
Pour finir sur ce point, si l’état d’urgence a été levé en France, le législateur a intégré dans le droit commun de la police administrative un certain nombre des mesures qu’il prévoyait et qui, pour certaines, ne pouvaient être décidées que par l’autorité de police judiciaire (Loi n° 2017-1510, 30 oct. 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. On peut citer, par exemple : les périmètres de protection (CSI, art. L. 226-1 s.), la fermeture des lieux de culte (CSI, art. L. 227-1 s.), le placement des personnes sous contrôle administratif et sous surveillance (CSI, art. L. 228-1 s.) les visites et saisies (CSI, art. L. 229-1 s.). Les perquisitions reviennent quant à elles dans le giron de la police judiciaire
5° Le droit administratif est confronté à la dématérialisation
Les deux années qui viennent de s’écouler ont vu se multiplier les productions scientifiques ainsi que les colloques consacrés aux enjeux du numérique et des nouvelles technologies en droit administratif.
Le développement des usages numériques en droit administratif s’appréhende de multiples façons dont on peut retenir quelques illustrations récentes qui soulèvent des questions pratiques et théoriques très intéressantes : par exemple, de quelle manière la théorie de l’acte administratif va-t-elle être amenée à évoluer afin de tenir compte non seulement de la dématérialisation des rapports entre l’administration et les administrés, mais également de l’utilisation de plus en plus fréquente de logiciels et d’algorithmes comme appui à la prise de décision.
Dans un premier mouvement, les relations entre l’administration et les administrés sont progressivement en train de se dématérialiser malgré certaines limites récemment pointées du doigt par le défenseur des droits qui s’inquiète de l’existence d’une « fracture numérique » en France, c’est-à-dire de l’inégal accès des français à l’internet. Cette dématérialisation s’opère dans un double sens :
Des administrés vers l’administration ou vers le juge tout d’abord : le Code des relations entre le public et l’administration consacre en effet le droit de tout administré de saisir l’administration par voie électronique (L.112-8). Parallèlement, est en train d’être expérimenté la possibilité pour les justiciables de saisir le tribunal administratif par internet. De même, à l’automne prochain sera généralisée la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics.
De l’administration vers les administrés ensuite, puisque les pouvoirs publics peuvent ou doivent – selon le cas – utiliser internet en vue soit de transmettre ou de rendre accessibles aux administrés un certain nombre d’informations qu’ils peuvent librement réutiliser (ce que l’on nomme l’open-data) ; soit de les solliciter dans le cadre de consultations ouvertes en ligne.
Dans un second mouvement, la prise de décision par l’administration repose dans un nombre de plus en plus important de cas sur l’utilisation de logiciels ou d’algorithmes d’aide à la décision qui lui permettent de traiter un nombre colossal d’informations. Cette possibilité a fait l’objet d’un encadrement législatif fixant les conditions dans lesquelles l’administration peut avoir recours aux algorithmes pour l’adoption de décisions individuelles : ainsi le Code des relations entre le public et l’administration impose-t-il à l’administration, lorsqu’elle adopte une décision individuelle sur le fondement d’un algorithme, d’en informer le destinataire qui dispose du droit de se voir communiquer les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre. Par ailleurs, la loi impose à l’administration de publier en ligne les règles définissant les principaux traitements algorithmiques utilisés dans l’accomplissement de leurs missions lorsqu’ils fondent des décisions individuelles.
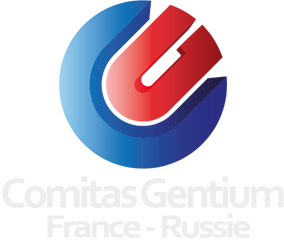


Recent Comments